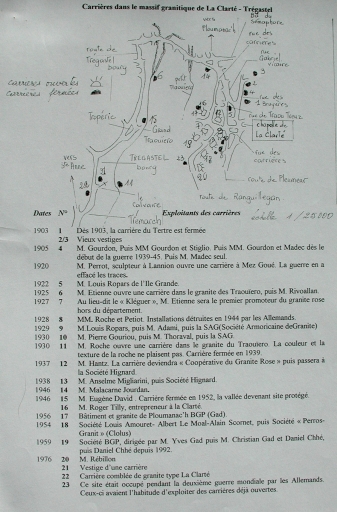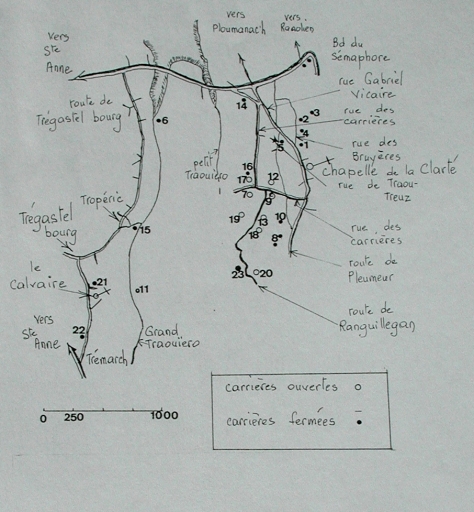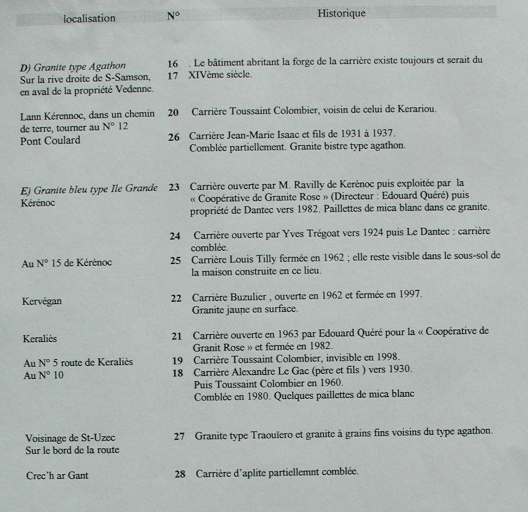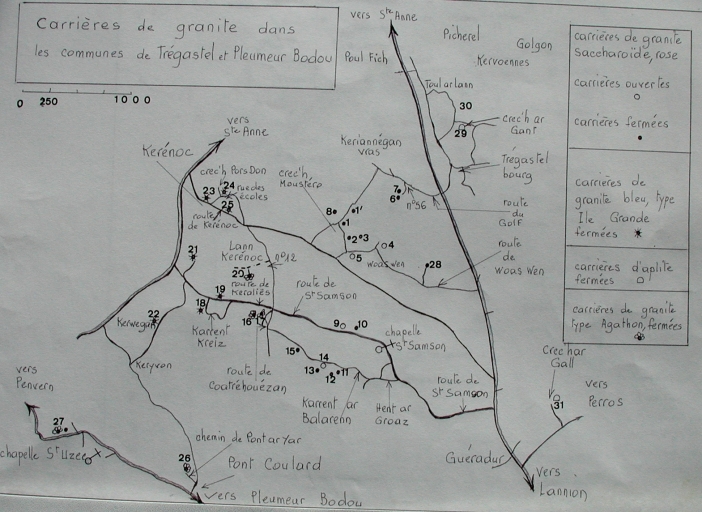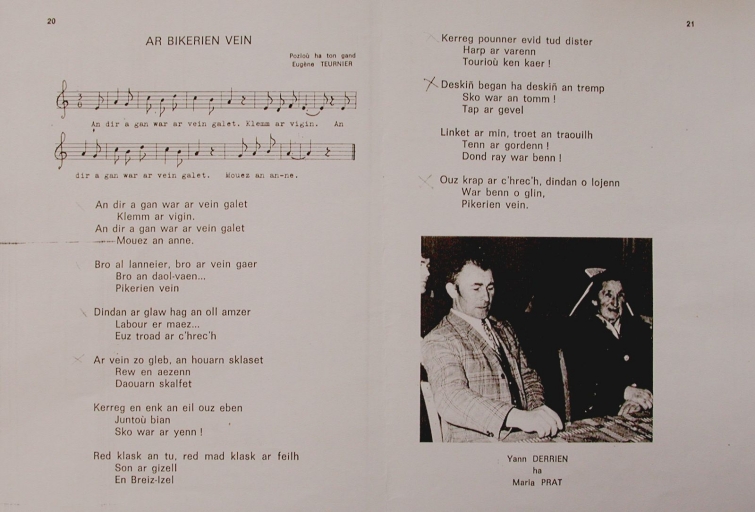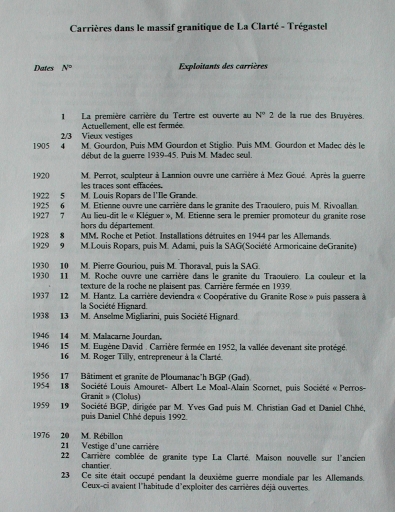Interview de Alain Scornet, frère de Marie-Denise Daniel, " Mein ma Bro" à Trégastel le 1er février 1994. Témoignage recueilli par Y. Jouan.
Alain Scornet est né d'un père marin en 1924 à Perros Guirec, son frère est marin, sa vocation naturelle est de les suivre mais la guerre en décidera autrement.
1936 : Alain a 12 ans, les grèves éclatent sur le site ; les ouvriers se regroupent à la carrière Madec. De nombreux italiens animent les débats "bon enfant" en jouant de la mandoline. En compagnie de nombreux enfants, Alain assiste, en plein air aux discussions. De belles voix de "ténor" s'élèvent lorsque le cortège s'ébranle en direction de la Mairie de Perros. Il fait beau. Les gamins précèdent ou suivent le groupe. Heureux de faire "la fête", de participer et d'être utile, Alain fait la quête à l'aide d'une gamelle qui lui a été remise. On descend sur la plage où les touristes font résonner leur participation pécuniaire pour aider ceux qui ne seront pas payés. Sans doute est-ce là que naît sa vocation de Secrétaire du syndicat C.G.T. qu'il exercera durant de nombreuses années afin de résoudre les "différents" et les problèmes des uns et des autres et créer un esprit de solidarité.
1949 : A la carrière Madec où il débute comme tailleur, 70 personnes environ y travaillent. On y fait surtout du funéraire . de nombreux italiens venus après la 1ère guerre mondiale, vers les années 1930, travaillent sur le site. Ce sont les Bertolo, Otolina... mais très vite la carrière - comme toutes les carrières du site - est réquisitionnée par les allemands et avec le groupe de la T.O.D.T., A Scornet taille des claveaux pour réaliser les bases des pilotis de la base sous-marine de Lorient. Ces claveaux, rassemblés et empilés formeront les colonnes immergées qui soutiendront le béton protecteur anti-bombes. Il faut faire vite ; les allemands (seuls clients) passent les commandes, exigent le respect des délais et paient.
La douzaine de jeunes que nous étions étaient heureux de notre sort, pas question pour nous d'aller n Allemagne et pour midi, nous avions gagné notre journée car nous étions bien payés ! Nous travaillions à la tâche. La guerre se termine et de nombreux claveaux restent sur place... .
1947 : Alain travaille à la Société Coopérative, " Le Granit Rose." La journée commence vers 7 H 30. L'usure des poinçons est tellement rapide que pour le casse-croûte de 9 heures chacun en rapporte une bonne brassée à la grande forge située tout en haut et où s'activent deux forgerons. C'est l'époque de Gaby, d'Henri Belloir, d'Yves Bricquir de Pierre Thomas, d'Yves Milin. Ceux qui viennent de loin apportent dans leur musette gamelle et pot de soupe qui seront chauffés à la forge. Le soir chacun rentre chez soi.
Les outils du carrier :
Le carrier qui assure l'extraction provoque l'explosion de la mine à l'aide de la poudre noire et remonte le bloc avec une "chèvre". C'est un jeu de poulies fixées sur deux arbres maintenus par quatre haubans fixés dans le roc et qui sont réglés de manière à ce que la chèvre se balance dans la manoeuvre. Lorsque la chèvre, penchée vers l'exploitation, tire vers le rebord, elle se rapproche de la verticale à mesure que le bloc lui-même arrive à la verticale, les haubans font contrepoids et règlent la remontée tout doucement à mesure que le treuil vire le bloc. Le travail doit être surveillé de très près. Le danger est toujours présent, les pieds peuvent déraper et tout peut casser.
A cette époque on ne creuse guère à plus de 10 mètres de profondeur pour obtenir du granit sain. On rencontre de nombreux défauts : le fil est un trait net qui coupe la masse de granité ; s'il se présente en diagonale, il y a beaucoup de perte. La dureté s'apprécie à l'oeil. Ils sont tous chaussés de sabots de bois cloutés et cerclés - heureusement, la forge est là - A cette époque le compresseur ne faisait que 2 m à l'heure contre 10 m. actuellement.
Chaque tailleur possède, en plus de sa masse, deux massettes : une grosse
pour la "grosse bûche" et une petite pour travailler au ciseau. Chaque
ouvrier emmanche ses outils en bois d'orme ou de noisetier.
Le "têtu", outil très ancien était pratique parce qu'un seul ouvrier suffisait pour
s'en servir tandis que le "chasse" qui l'a remplacé, nécessite deux personnes :
une pour tenir et une autre pour taper. Actuellement personne ne sait plus
travailler au têtu. Le chasse dégrossit et passe avant le "piche" qui coupe,
redresse les arêtes et fait les finitions.
L'apprentissage se fait sur le tas "avec un chef.
Il faut apprendre à se protéger les yeux avec les mains et le coude. Il faut donc placer le coude d'une manière bien précise afin de prévenir les éclats qui abîmeraient à jamais la cornée de l'oeil. Le coude servira donc de bouclier.
La taille se fait devant ou dans des cabanes ouvertes qui permettent de s'abriter en cas de mauvais temps.
La reconstruction des phares
Le phare des Sept-Îles :
La guerre a provoqué les destructions des phares et des ports ; il faut y pallier rapidement . A. Scornet et une cinquantaine de compagnons vont à l'île aux moines pour reconstruire le phare des Sept Iles. Ils sont cinq ou six de Perros (Jean Guélou de Ploumanac'h, Tilly de la Clarté qui était chef maçon). Une partie des pierres est extraite dans l'île : c'est un joli granite bleu, plus foncé que celui de l'Ile Grande qui sera façonné sur place. L'autre partie est apportée de La Clarté, façonné ou non, par bateau. Pour que les bateaux puissent accoster afin d'apporter ces blocs, il faut construire la calle afin de débarquer tout le matériel. Le"Roche Douvres" et le "Roche Gautier" des Ponts et Chaussées de Lézardrieux assureront durant plusieurs années le trafic. Les Ponts ont fourni un dortoir, un réfectoire, une cuisine avec son chef-cuistot de la marine et son aide ; le tout comme à la caserne. Le dimanche on rentre chez soi et le lundi matin embarquement du personnel et du ravitaillement pour la semaine.
Pour extraire le granité sur place, on tape dans la butte et les blocs tombent. Plus besoin de chèvre ! En cas de besoin un compresseur facilitera l'extraction. Cette carrière donne de petits morceaux ; c'est du travail à pied d'oeuvre. Avant de tailler les blocs on les monte dans la cabane au pied du phare. Une jeep américaine et son chauffeur assureront le transport Bonne ambiance, c'était le bon temps, ajoute Alain. Les fêtes étaient monnaie courante et le cuisinier mis à l'épreuve pour un repas plus soigné et bien arrosé. Le soir il faut se distraire. Qu'à cela ne tienne, on construit des allées de boules.
La reconstruction du phare des Roches-Douvres et des Héaux de Bréhat
Pour la reconstruction des phares des Roches Douvres et des Héaux de Bréhat, A. Scornet travaille à La Clarté comme salarié à la Coopérative "Le Granit Rose" puis dans des cabanes du parc des Ponts et Chaussées de Lézardrieux. Seuls les maçons participeront à la mise en place dans les îles. Comme tous les travailleurs indépendants ils doivent alors payer leurs charges.
1952 / 53 : A. Scornet travaille un moment au carrefour de Ploumanac'h avec Amourette dans une cabane en bois.
1954 : II rouvre une carrière toute envahie de ronces et d'ajoncs sur la route de Ranguillégan et prend un troisième associé : Le Moal.
Période très difficile par manque de matériel. Aucune aide, seulement une brouette et une pelle : c'est la misère !
Sur le quai du port de commerce de Brest vivent des ferrailleurs (L'Hermite et
Le Braz), Alain va leur rendre visite, détecte du matériel encore utilisable
avant leur découpage (treuils, grues) provenant de la marine et laissé par les
Allemands. Il faut fouiller et se présenter au bon moment. Le camion de "La
Perrosienne" fait la navette Brest-Perros pour le transport.
Peu de matériel et pas d'argent !
Durant le premier hiver se pose le problème de l'évacuation de l'eau. Il
fabrique un siphon devenu vite insuffisant. Il faut une pompe, on a de l'eau
jusqu'aux genoux. Les Etablissements Nogues de Lannion consentent un
crédit de 15 000F qui sera payé par les versements de 5 000 F des trois
associés pour l'achat d'une pompe Bernard.
La première grue ramenée de Brest monte 18 tonnes, prix .130 000 F
1956 : le temps de la reconstruction urbaine
Alain embauche des ouvriers, dont Jean Guélou, tailleur qui habite Randreux. Ses clients sont des marbriers habitant diverses villes surtout Rouen. Le travail concerne le funéraire, livré façonné et poli ainsi que le bâtiment . Au meilleur moment de cette période ils sont 14 ouvriers sur ce chantier.
Cependant, le granite noir d'Afrique fait une sérieuse concurrence au "rosé de La Clarté" concernant les pierres tombales. Alain décide de rouvrir une 2ème carrière à Lanvellec entre Plouaret et Plestin afin d'avoir le choix d'une autre couleur. Lanvellec a un granité foncé plus funéraire que le rosé. Il loue donc cette carrière qui avait été ouverte avant lui, à un propriétaire fermier. Il faut donc monter un treuil, un compresseur, faire 30 Kms par jour en camion dans lequel il ramène un bloc presque tous les soirs. Les pertes sont énormes (défauts, fils) Personne ne reprendra cette carrière après lui. D'autres granitiers exploiteront sur St-Carré mais à Lanvellec il est seul. Pour recruter du personnel, Alain va voir les ouvriers des autres carrières, leur propose un meilleur salaire et... le tour est joué ; c'est l'habitude. Beaucoup de travail et la difficulté de fournir pour la reconstruction qui bat son plein. Les commandes s'accumulent. Il a 10 constructions en route en même temps (5 clients à St-Brieuc, à Plestin, en Ille et Vilaine, dans le Finistère...) : c'est la belle époque.
A. Scornet part aussi au Havre, avec 4 ou 5 compagnons. Ils sont très attendus. Il s'agit de mettre en état les quais bombardés pendant la guerre. Il faut permettre au long courrier transatlantique le "Normandie" d'accoster, et restaurer d'urgence le port de commerce Travail du dimanche rémunéré à 150 %., Il récupère les pierres abîmées, voit une autre manière de travailler. Il parcourt divers chantiers : Bécon les Granits, Lanhélen, Saumur, avec sa petite valise, sa massette et le piche.
1960 / 1970 : Quatre tailleurs se consacrent uniquement aux pierres nécessaires au bâtiment. Les problèmes se déplacent . Cette fois il faut réparer le matériel : 2 millions, puis 5 millions pour réparer un engin, faire venir un vilebrequin d'Angleterre et le budget repart à zéro.
Il faut louer un compresseur. Pour l'utiliser à temps plein et diminuer les frais, on prépare les blocs en fonction des jours de location. C'est un compresseur à piston vertical, entraîné par une courroie de 6 m. de long, avec un moteur à essence de 25 CV qui ruine en prix de revient d'essence. C'est le désastre budgétaire.
A La Clarté vit M. Thépaut, mécanicien spécialisé pour l'entretien du matériel utilisé sur le site. Compétent et très bien outillé, c'est l'homme de tous les conseils. Il accompagne Alain pour guider son choix à Ergué-Armel près de Quimper pour l'achat d'un vieux compresseur . Il l'avait déjà accompagné à Brest. Maintenant if répare et dépanne le matériel de toutes les carrières.
Les conditions de travail : Le patron carrier n'a jamais fini son travail ; il extrait, vend, gère, recrute, Il n'a jamais fini sa journée ni sa semaine. Ni dimanche ni congé. A. Scornet nous dit avoir eu un travail ininterrompu durant 15 ans. A 6 heures du matin il faut allumer la forge. On s'éclaire à la lampe à carbure. Pas d'électricité et quand la fée lumière sera là, il lui faudra payer un transformateur pour en diminuer le prix de revient
Le carrier n'a pas le droit d'être malade. Il lui faut une santé de fer ou d'acier ! La solidarité joue à plein dans les cas de malheur (santé irrémédiablement perdue ou accident). Tout est fait pour que l'associé touché soit rémunéré comme s'il travaillait. Bravo ! Durant ces années seuls quelques jours de gel ont arrêté l'extraction.
Sculpteurs et graveurs : une spécialité des tailleurs de pierre :
Jobig Tadier est le premier sculpteur de la région. Il a décoré sa maison, derrière chez Ignolin, de sculptures en gargouilles, de corbelets à têtes d'animaux. Il s'est fait son monument funéraire avec une très belle croix (à gauche, vers le milieu de la 1ère partie du cimetière de La Clarté). Après avoir"habillé et meublé" tant de morts, ajoute Alain, chacun prépare sa tombe.
Sur ces tombes, on fait appel aux graveurs. C'est M. Esnol, le 1er venu travailler chez lui. Il y a aussi la fille de M. Hantz.
Quelques anecdotes :
Après la guerre 14 /18, au café de La Clarté on débitait une barrique de vin par jour ; certains ne reprenaient le travail que le mercredi. Beaucoup d'alcoolisme en ce temps là !
Un carrier, nommé "Merrer Braz" parce qu'il mesurait 2m20 lançait, à partir de Mez Gouez, une pierre jusqu'à Ranguillégan. Grand et fort, il est mort jeune.
La petite boutique de Mlle Lamour attire une nuée d'enfants qui jouent au foot dans l'enclos de la chapelle. Lorsque le ballon atteint ses carreaux, elle sort furieuse en vociférant : C'est toujours la même bande. Mais la bande a vite disparu pour un temps.