Cinq îlots de la myriade d'îles qui font partie de l'archipel de Bréhat peuvent être associés à travers leur dénomination ou à partir de données textuelles, à une présence cénobitique ou érémitique ancienne : Béniguet, Modez, Saint-Riom (ou Saint-Rion), Lavrec et l'Île Verte. Saint Rion fut le fondateur présumé de l'oratoire situé sur l'île de caro ou 'Carv-Enez' ('île du Cerf' ou 'île de la chèvre' (Guirvinil en 1184). Cependant aucune trace de monachisme ancien ne peut être attribuée à Saint-Rion. Quelques vestiges de cellules monastiques sont situés à la pointe aux Courlis, cachés sous la végétation, ainsi que la digue des Moines au sud-Ouest et les trois pêcheries. Dépourvu de vie ancienne, saint Rion est peu connu dans la vie des saints. Le chanoine Guillaume obtint en 1198 une bulle du pape Innocent III, par laquelle ce pontife prenait sous sa protection le monastère de Saint-Rion dans l'île de Carohènes et les religieux de Saint-Victor qui y étaient établis. Une abbaye fut donc construite sous son vocable en 1184 par Alain d'Avaugour. L'abbaye posséda le chef de saint Rion jusqu'en 1202, date à laquelle les moines (Augustins de Saint-Victor de Paris) quittèrent leur insularité pour Beauport. La charte de 1202, dite de Beauport, confirme la naissance de l'abbaye de Beauport et le transfert des biens de l'île Saint-Rion à Beauport. L'île est restée une dépendance de l'abbaye de Beauport pendant les siècles suivants avant d'être abandonnée au 18ème siècle. En 1875, l'île appartenait à l'armateur paimpolais Armez et on pouvait remarquer la présence de trois maisons, dont la ferme de l'île. Saint-Rion a ensuite été la propriété de différentes familles et utilisée comme résidence estivale. En 1900, la famille Hamelle en était propriétaire. L'île était en friches, habitée par un berger et ses moutons. La chapelle et les anciens bâtiments conventuels en ruine furent rénovés et transformés en habitations. Les terres commencèrent d'être exploitées et de nouvelles plantations d'agrément furent aménagées (chênes verts, aulnes, eucalyptus). On construisit même une nouvelle maison d'inspiration normande. La toponymie de l'île fut enrichie par les noms donnés par les nouveaux résidents aux pointes et aux plages de l'île. Puis ce fut la famille Laniel qui hérita par alliance de l'île. La propriété fut ensuite vendue en 1973 à la famille Gachet. L'île appartient aujourd'hui à un consortium privé. D'importants travaux de rénovation de l'ensemble des bâtiments sont en cours. L'île Saint-Rion a été remise en culture par la famille Guillaume Bouchard en 1978 (polyculture maraîchère). la tempête de 1987 a parachevé les travaux de défrichement, commencés en 1985 (défrichage de la pointe Est de l'île) et a contribué au déboisement de l'île. L'île est entretenue et gérée par le biais d'une agriculture extensive, de grande qualité agronomique (pommes de terre nouvelles et 'de fin de siècle'). Une activité ostréicole complète la vocation économique de l'île et de son estran, avec une production de type extensif, au sol d'huîtres plates. L'île est située dans le périmètre d'un site classé (25 novembre 1981) et la socité Saint-Rion SA, propriétaire de la totalité de l'île a demandé une protection. Une convention de gestion (selon des principes écologiques et de développement durable) a été signée en 1999 entre le Conservatoire du Littoral et le propriétaire de l'Île Saint-Rion. Les clauses de cette convention permettent le maintien de l'agriculture et assurent une gestion patrimoniale du bâti et de l'environnement.
- inventaire préliminaire, Ploubazlanec
Dossier non géolocalisé
-
Aire d'étude et canton
Bretagne - Paimpol
-
Commune
Ploubazlanec
-
Dénominationsécart
-
AppellationsSaint-Riom
-
Période(s)
- Principale : 3e quart 12e siècle
- Principale : 18e siècle
- Principale : 19e siècle
- Principale : 20e siècle
L'île Saint-Riom se trouve à 1, 5 km au large de la pointe de Porz Even. C'est la plus méridionale des îles bordant l'Est et les rivages de la commune de Ploubazlanec. Elle s'allonge sur 721 mètres suivant une orientation sensiblement Est/Ouest et sa plus grande largeur est de 350 mètres. Son sommet culmine à environ 40 mètres. Elle couvre une superficie de 9 ha, possède un relief relativement accidenté et les parcelles épousent les différentes dépressions orographiques. Les 4 hectares de terres cultivées (à l'Ouest, au Sud-Ouest et au Nord-Est) sont enrichis avec les amendements marins. Ces terres sont travaillées par un cultivateur avec l'aide d'un tracteur et d'un cheval pour les petites parcelles (binage, labour et charriage des landes fauchées). La production de pommes de terres (100 tonnes annuelles), en particulier de pommes de terre nouvelles, est vendue sur le continent aux grandes surfaces et aux restaurateurs. La Pointe Est de l'île est vouée aux prairies et aux pâtures permanentes (0, 5 ha). Le cadastre de 1982 relève 17 parcelles sur l'île, dont 3 parcelles (au Nord) correspondant aux trois maisons d'habitation. L'île est constituée de trois pointes dont celle de la 'Pointe aux Courlis' et la plage du même nom à l'Ouest, la 'Roche et la plage aux Loutres' au Nord, la 'plage aux Mulets' au Nord-Est et la 'Pointe aux Moutons' à l'Est.
-
Statut de la propriétépropriété d'une société privée

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor
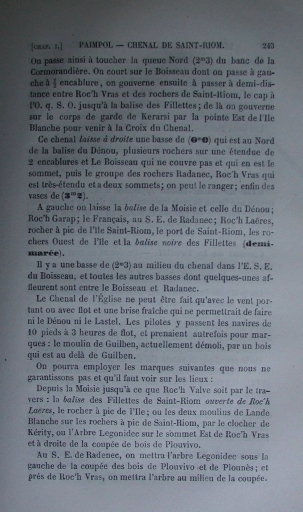
- (c) Collection particulière
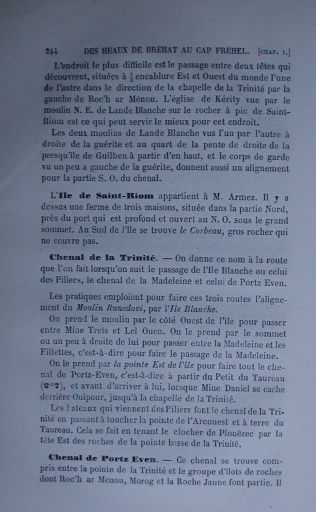
- (c) Collection particulière

- (c) Service Régional de l'Archéologie de Bretagne

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor
Bibliographie
-
AD Cotes-d'Armor. H 62. Publications dans dom Morice, Preuves, I, 32. - Geslin de Bourgogne et Anatole de Barthélemy, Anciens évêchés de Bretagne, histoire et monuments, IV, Paris, Hérold. - Saint Brieuc, Guyon, 1864, in 8°, p 8, Saint Rion, Pièce justificative n°1.
-
BRIGAND, Louis. Les îles du Ponant. Quimper : Editions Palantines, 2002.
-
CORNELIUS, Jean-Bernard, CORNELIUS, Marie. Saint-Rion, la longue histoire d'une petite île. Dans Bulletin de la Société d'Emulation des Côtes-du-Nord, Saint-Brieuc, CXII, 1983.
p. 1 -
HABASQUE. Notions historiques, géographiques, statistiques et agronomiques sur le littoral du département des Côtes du Nord. Saint-Brieuc : Guyon, 1832.
p. 218 -
LE BONNIEC, Yves. de Saint-Rion à Beauport. In : Abbaye de Beauport. Huit siècles d'histoire en Goëlo. Paimpol : Association des Amis de Beauport, 2002.
p. 23-24 -
OGEE. Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne : articles : Langueux, Cesson, Yffiniac, Hillion. Nantes : Molliex, 1778-1780, Rennes : Molliex, 1843.
-
THOMASSIN, Anastase. Pilote côtier, Côtes Nord de la France, troisième partie : Des Héaux de Bréhat au cap de la Hague. Paris : Challamel aîné, 1875.
p. 243 -
VIDAL, Tessa. Etude de l'Île Saint-Riom. Licence de Géo-architecture, sous la direction de Louis Brigand, Brest : UBO, 1995.
Documents figurés
-
AD Côtes-d'Armor. 4 NUM 1/25. Plans cadastraux parcellaires de 1832, Numplan 1/25. Documents consultables sur le site Internet http://archives.cotesdarmor.fr.
Documents audio
-
DOUEL, Gaël. L'homme de Saint-Riom. Film documentaire 52 mn, Z'azimut Films, France 3 Ouest, 2008.





