Le logis du Château de la Houssaye est une construction classique, avec une façade principale d’élévation ordonnancée à dix travées.
Le château classique
Le château, construit en petit appareil de granite, se distingue par sa verticalité, notamment grâce aux baies en arcs segmentaires qui s'alignent sur les quatre niveaux. Cette verticalité est également soulignée par le rez-de-chaussée surélevé, l'escalier à double volée et la toiture à la mansarde, qui permet d’ajouter un étage supplémentaire en plus de l'étage carré. En observant l'ensemble des façades, on remarque que la façade ouest, d'une grande envergure, s'attache à impressionner. L'effet est accentué par l'allée courbe qui permet de voir le château depuis un point plus bas. À l'inverse, la façade est, plus intimiste, présente un rez-de-jardin accessible par une passerelle qui surplombe une cour servant aux communs situés au sous-sol. L'avant corps central de ce côté est moins saillant, et la façade est moins ornée, sans chaînage d’angle en pierre de taille de granite ni bandeau en saillie marquant les niveaux. Il est important de préciser que les garde-corps des baies situées au rez-de-chaussée, installés au 20e siècle par le Baron Voruz de Vaux, proviennent d'un immeuble nantais. Ce dernier a également aménagé le parc dans un style du 18e siècle et décoré une chambre avec un décor en plâtre.
L’avant-corps central, sur la façade ouest, est légèrement en saillie et se distingue par une symétrie marquée. Cette symétrie est soulignée par un escalier à double volée aux montées convergentes, ainsi que par deux travées fortes sur deux niveaux, couronnées par un fronton triangulaire en pierre de calcaire. Ce fronton abritait les armoiries de la famille Le Vicomte, qui ont été martelées pendant la Révolution. L’ensemble est surmonté d’une toiture à mansarde, ornée d’épis de faîtage.
L’intérieur du château est agencé selon les normes idéales de l’époque (vers 1750). Le sous-sol abrite des caves ainsi que deux appartements, dont l'un est désigné comme l'office. Il comprend également une cuisine, reliée à un escalier de service qui mène à la grande salle à manger, équipée d’un monte-plat encore en état de fonctionnement.
Le rez-de-chaussée comporte six pièces. L’entrée, située dans l’avant-corps central, sert également de salle à manger. Elle est lambrissée, avec des moulures cintrées et une cheminée en bois. Au nord-est, se trouvent deux pièces : un bureau, qui était équipé selon l'inventaire dressé le 11 thermidor an IV (29 juillet 1796), d’un secrétaire, de cinq fauteuils et d’une malle, et une première chambre à coucher, où l’on trouvait un lit, deux confessionnaux, une table de jeu et une table simple. En plus des boiseries classées monuments historiques, cette première chambre était décorée de trois tapisseries de Beauvais. Elle mène à un petit cabinet, qui contenait, toujours selon l'inventaire du 11 thermidor an IV (29 juillet 1796), un lit, une chaise d’aisance et un bidet à dos. Au sud-ouest, deux salons, servant de salles de compagnie, sont dotés de lambris courbes et de cheminées en bois. Le premier salon était orné de deux tableaux de jeu et de tapisseries d’Aubusson, tandis que le second abritait quatre tables de jeu et un métier à broder. L’une de ces pièces a été transformée en cuisine. L'ensemble du rez-de-chaussée est parqueté (motifs de type Versailles ou à chevron pour les salles ou à lame de chêne pour les corridors). Dans cette partie ouest du château se trouve également la cage de l’escalier d’honneur. Il est en orme, avec un départ en rampe sculpté en aileron à volute rentrante et des balustres carrés en poire.
Cet escalier dessert les étages et mène au premier, où un grand corridor s’ouvre. Ce corridor distribue cinq chambres et un cabinet, toutes lambrissées, certaines avec des courbes et d’autres avec des lignes droites et toutes parquetées.Le 11 thermidor an IV (29 juillet 1796), lors de l'inventaire effectué par les commissaires républicains, les chambres sont dotées de lits, parfois ornés de draps en soie, de tables, de pots à eau, de glaces de toilette et de tables de nuit. Au 18e siècle, on comptait quatre cabinets et cinq chambres. Les quatre premières chambres possédaient des cheminées en marbre, tandis que la dernière était équipée d’une cheminée en bois sculpté avec un arc chantourné.
Le second étage, ajouté en surcroît, était destiné aux domestiques. Cet étage comprend un appartement avec une cheminée en granite, ainsi que huit chambres et deux cabinets.
Le château reflète l'élégance et le statut social de la noblesse parlementaire du XVIIIᵉ siècle. Commandé par un parlementaire et conçu par un architecte du même milieu, il allie esthétique et fonctionnalité. Les volumes harmonieux, les façades équilibrées et les aménagements intérieurs témoignent de la recherche d'une beauté raffinée, tout en répondant aux besoins pratiques d'une vie de cour. L'inventaire du 11 thermidor an IV (29 juillet 1796) met en évidence la variété des éléments de confort adaptés aux standards de l'époque.
Le parc et ses aménagements
Le parc du château, qui s'étend sur environ 13 hectares, comprend un potager de 34 ares datant du 18e siècle, ainsi qu'un moulin appelé « Martel », restauré par le Baron Voruz de Vaux au 20e siècle. Ce jardin, à la fois classique et influencé par les jardins à la française, a été conçu au 18e siècle, à une époque où les jardins paysagers se développaient, d'abord sous l'influence de l'école classique de Le Nôtre. Par la suite, il a été modifié par les propriétaires actuels, dont Inès de Largentaye, vers 1960, qui y a introduit un jardin anglais. Le jardin à la française, avec ses buis taillés et ses allées dessinées en croix autour d’un bassin central, se distingue par des allées de tilleuls qui ajoutent un charme et permettent une promenade, élément essentiel du « vivre noblement ». Au 20e siècle, sous l’impulsion du Baron Voruz de Vaux, le parc a subi des transformations, notamment avec la création d’une allée courbe qui redessine le parcours menant au château, lui conférant ainsi une touche anglomane marquée.
Le colombier et la chapelle
Le colombier, datant de la fin du 15e siècle, est un élément important du domaine. Classé Monument Historique depuis 1982, il est un symbole de droits seigneuriaux indéniables en plus d’être le lieu d’une ressource précieuse que sont les pigeons, pour tout seigneur. Ce colombier a été restauré dans les années 1960, c’est pourquoi il est en excellent état et préserve ainsi son caractère historique. Il possède 1600 boulins signifiant la domination de 800 hectares par le seigneur qui l’a bâti, probablement les Coesquen, à la fin du 16e siècle. Il est constitué en gros œuvre d’un appareil assisé en granite. Il avait une litre aujourd’hui à peine visible et qui permettait de consolider l’édifice.
La chapelle, construite probablement aux 15e et début du 16e siècle, a subi des transformations au 18e siècle. Sa façade sud présente un portail occidental avec des colonnettes engagées dans l’embrasement, une voussure appareillée en rouleaux, et au-dessus, un oculus. La façade nord, quant à elle, possède deux petites baies jumelées et cintrées, réalisées probablement au 18e siècle. Sur les façades est et ouest, on trouve également deux autres baies. Malgré ces ouvertures, la chapelle demeure sombre, avec un dallage en petits carreaux et des murs enduits. La charpente était vraisemblablement à l'origine recouverte d’un lambris. La chapelle mesure 11 mètres de long pour 6 mètres de large. Elle a été le lieu de baptême de Renaud, fils de Jean-Baptiste Le Vicomte, en 1779, et accueillait deux messes annuelles selon les archives. Le culte y fut supprimé pendant la Révolution, rétabli en l’an XI (1802-1803), puis la chapelle fut désaffectée au 19e siècle. Elle a été classée Monument Historique en 2020.
Au fil du temps, de nombreuses modifications ont été apportées au domaine. Ces transformations ont principalement touché le jardin et les intérieurs du château, visant à restaurer l’élégance des lieux et à préserver leur caractère historique. Les différents propriétaires successifs ont chacun contribué à leur manière à l’embellissement et à la conservation de l’ensemble.
(Flavie Dupont, Inventaire thématique des demeures parlementaires, 2025)
















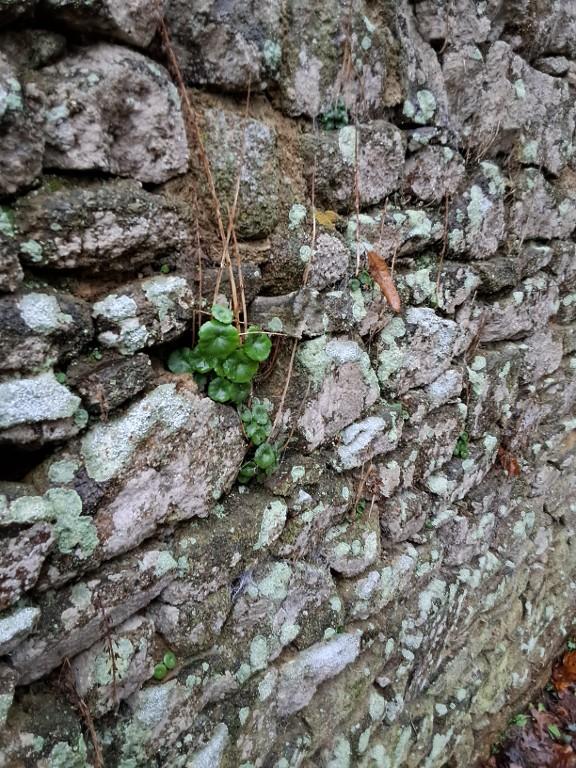


Etudiante à l'Université Rennes 2, master 2 Histoire, civilisations et patrimoine double parcours Histoire et Sciences-sociales et parcours Médiation du Patrimoine de l'Histoire et des Territoires.
Dans le cadre d'une étude sur les châteaux parlementaires costarmoricains pour la réalisation d'un mémoire de recherche historique sur les châteaux habités par des parlementaires bretons. En partenariat avec l'association VMF et la Région Bretagne.