Une tradition rapportée par Guillotin de Corson veut qu'à l'origine de la paroisse, deux moines en quête d'un havre de paix aient fondé un monastère à l'emplacement du hameau de la Chapelle, où un sanctuaire dédié à saint Pabu conservait le souvenir de saint Tugdual tandis que son compère donnait son nom à la paroisse. Ce pendant, la "parochia Sancti Briaci" n'apparaît dans les chartes qu'au XIIIe siècle et semble n'avoir que tardivement acquis son autonomie à l'égard de la vaste "plebs" primitive de Pleurtuit, au diocèse d'Aleth.
Sa création n'est peut être pas sans rapport avec l'émergence de la seigneurie du Houlle, constituée sans doute pour un vassal du vicomte de Poudouvre, dont la fonction de garde-côte se déduit clairement du site éponyme. Le château fort de La Houlle, cité dans le fameux Roman d'Aquin dès le XIIe siècle, se dressait sur l'actuelle presqu'île du Nessay, en position de commander l'estuaire du Frémur.
A partir de 1650, la famille de Pontbriand, dont le fief originel tout proche était situé sur le territoire de Saint-Lunaire, réunit l'ensemble des juridictions seigneuriales de la paroisse à leur possessions : après La Houlle, la Garde et la Ville-aux-Provôts échoient en 1682 dans son escarcelle.
Sous l'impulsion des "Messieurs de Saint-Malo", l'activité maritime semble connaître un net essor remarqué en 1733 par l'intendant des Gallois de La Tour dans son Mémoire : Les habitants de Saint-Briac "font le cabotage de Bordeaux, La Rochelle et Le Croisic, et dans tous les autres lieux où les maîtres de barques trouvent à gagner. Ils sont tous à leur aise". La pêche paraît assez marginale dans ce contexte où le sel de la baie de Bourgneuf et le vin bordelais sont les principaux produits de ce trafic maritime, sans doute en grande partie lié à l'approvisionnement du grand port voisin. Si quelques cales sont attestées aux alentours du havre, on ne trouve guère mention de grands armements, sans doute à cause de l'impossibilité d'accueillir des navires de fort tonnage ; ce qui explique aussi l'absence des grand négociants internationaux.
La descente des Anglais à la Garde-Guérin en 1758 n'est qu'un épisode sans conséquences funestes. Même si la côte comme le bourg comptent en regard des paroisses voisines un nombre important de maisons incendiées, ce raid na pas remis en cause une prospérité qui se poursuit apparemment jusqu'au milieu du XIXe siècle. L'engouement pour les bains de mer viendra à point prendre le relais de cette activité en déclin à la Belle époque qui voit la création de la station balnéaire.








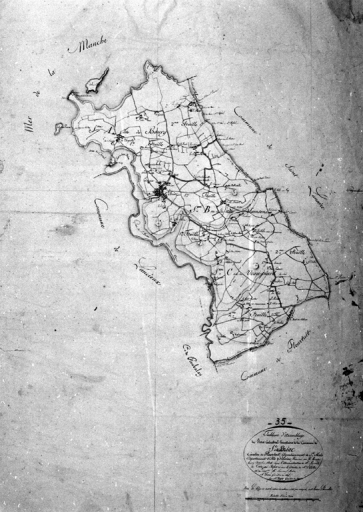
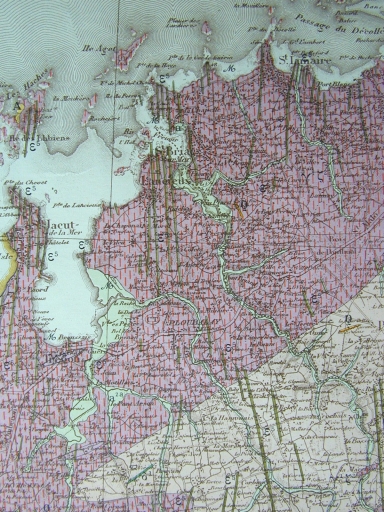
















Photographe à l'Inventaire