L´ancien hôtel Michau de Ruberso, construit vers 1720, était constitué de deux corps de logis. Le corps principal, entre une vaste cour au sud et un parterre au nord, comprenait une aile en retour à l´ouest, en léger décrochement, abritant un large escalier à vide central encore en place ; l´autre corps prolongeait à l´est, dans le même alignement le premier, avec un décalage de niveaux adapté à la pente du terrain (ceci est bien visible sur les plans de l´architecte Binet de 1810). Au sud de ce dernier corps de logis se trouvait la cour des communs. Cet hôtel, vendu en 1733 au président du parlement Cornulier, sert de 1770 à la Révolution de résidence à l´Intendant de Bretagne et devient, dès l´Empire, hôtel de la Préfecture. En 1872 les architectes Béziers-Lafosse, Martenot et Langlois réaménagent entièrement le site et les bâtiments. Un nouvel alignement de voirie prolonge le tracé de l´aile ouest, vers le nord jusqu´à l´angle du jardin et agrandit la cour vers le sud du côté du contour de la Motte. Le corps principal est doublé au nord pour recevoir au rez-de-chaussée la salle du Conseil Général et à l´étage une salle des fêtes. Les élévations sont entièrement reprises. Le corps principal est coiffé d´un toit brisé et surhaussé à ses extrémités pour recevoir de hauts toits en pavillon qui le ramènent vers le style du XVIIe siècle. Au milieu de la façade un large fronton curviligne est sculpté par Barré de deux figures allégoriques surmontant un cartouche aux armes de Bretagne. L´aile ouest au contraire, couverte d´un toit terrasse et couronnée par une balustrade, reçoit un pendant en trompe-l´oeil sous la forme d´un pavillon carré abritant une nouvelle conciergerie. Un troisième corps enfin, accolé à l´est et construit dans le style brique et pierre, abrite les bureaux des services de la Préfecture. La mise en scène de l´ensemble marquée par l´éclectisme officiel hérité du second Empire est parachevée par une clôture continue sur le Contour de la Motte fermée par des grilles de ferronnerie ornées, très proches de celles du Thabor. Dans l´angle de la cour un nouveau perron couvert d´une large marquise soutenue par des colonnes de fonte permet de descendre de voiture à l'abri des intempéries.
Lors de cette même campagne de travaux, on procède à un réaménagement complet des intérieurs qui remploient nombre d´éléments de décor du XVIIIe siècle. Seule la cage d´escalier, située depuis le XVIIIe dans l´angle nord-ouest de l´hôtel, semble avoir été peu modifiée. Sa composition ample, son parement à tables moulurées, la qualité de sa stéréotomie, de même que la retombée du palier voûté de l´étage sur deux pilastres ioniques à pendentifs, le dessin à rangs d´arcades de la rampe d´origine, le modèle des portes à médaillons ovales et riche mouluration grand cadre, sont autant d´éléments qui témoignent de l´influence du style de Jacques Gabriel.
Il est d´ailleurs intéressant de noter que le principe de corps de logis simples en profondeur, composés en U ou en équerre, avec escalier rejeté dans l´angle fut d´abord retenu vers 1725 par Gabriel pour ses premiers projets d´hôtel pour le commandant en chef de la province sur la place Neuve, face au nouvel hôtel de Ville. D´autre part, dans l´aile ouest de l´hôtel de Ruberso, l´emploi de baies plein cintre surmontées d´arcs à retombée sur corniche moulurée se retrouve sur un projet de Gabriel pour l´hôtel de Ville de Rennes daté de 1728.
Au cours des travaux de 1875, les intérieurs ont été entièrement redistribués et redécorés. Les pièces de réception de l´hôtel qui se trouvaient au XVIIIe siècle au rez-de-chaussée, avaient déjà été transférées à l´étage dès le début du XIXe, afin de libérer de l´espace pour les bureaux des services préfectoraux. Le doublage du corps principal sur son côté nord effectué par Martenot et Béziers-Lafosse, offre désormais, à l´étage un vaste espace de réception conforme au statut du représentent de l´État. Ainsi s´enchaînent selon la mode du temps, au débouché du grand escalier, un petit et un grand salon, réunis par une baie libre centrale formant vue. Ce même grand salon, formé de la réunion de deux anciennes pièces, peut aussi éventuellement ouvrir, au nord sur la toute nouvelle salle des fêtes.
Cette salle des fêtes, destinée aux grandes réceptions officielles ainsi qu´aux bals, a conservé l´intégralité de son décor, d´esprit encore très Second Empire, conçu par l´architecte Roy. A ses deux extrémités de belles cheminées de calcaire dur, sculptées par Barré, illustrent le thème du Jour et de la Nuit encadrées par les figures en cariatide des quatre saisons. Sur le pourtour, un ordre de pilastres corinthiens permet en outre, d´escamoter la saillie de l´ancien avant-corps sur jardin. Les travées, traitées en doubles portes, une partie des lambris et le revers des volets intérieurs sont abondamment garnis de glaces destinées à démultiplier l´éclairage des trois grands lustres à cristaux et de la série d´appliques accrochées à la périphérie. Une fausse voûte à lunettes ornées des armoiries des différentes sous-préfectures du département, dans un décor de rinceaux semblable à celui exécuté peu de temps auparavant par Langlois pour la cathédrale de Rennes, des caissons peints de putti volants dus à l´atelier rennais Jobbé-Duval, constituent ici un décor éclectique d´un luxe un peu lourd, très représentatif du style officiel des années 1875-80. Autour de cette salle enfin, les portraits de grandes figures historiques de la Bretagne, de la Duchesse Anne à Châteaubriant en passant par Jacques Cartier et Madame de Sévigné associés à ceux du maire de Rennes Leperdit et du conventionnel Toullier, disposés sur des fonds à mouchetures d´hermine, fournissent une iconographie de ralliement susceptible, dans la toute jeune troisième république, de ne pas heurter des élites de sensibilité politique diverse. Le fronton sculpté par Barré sur la façade d´arrivée, timbré des armes de Bretagne n´avait pas non plus d´autre mission.








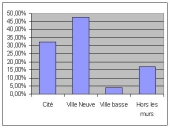

Architecte de la ville de Rennes (1858-1894)