Remarquable ferme du début du 19e siècle, dont l'élévation ordonnancée du logis identique à celle de l'étable, la forme des ouvertures, sont inspirées des modèles urbains comme à Port-Louis ou Lorient.
Cette ferme est particulièrement intéressante en raison de son rapport à l'architecture urbaine, identifiable à plusieurs traits. La présence d'un calice sculpté sur la pierre insérée dans la façade sud peut établir un lien soit avec l'abbaye de la Joie d'Hennebont, possesseur avant la Révolution de plusieurs tenues du hameau, soit avec un ecclésiastique ; il ne faut cependant pas exclure la possibilité d'un remploi d'un édifice antérieur. La recherche des propriétaires et constructeurs, inconnus, reste à faire.
La façade et la distribution s'apparentent à celle d'un logis urbain : outre l'élévation ordonnancée des deux parties, le contraste créé entre le soubassement en pierre de taille et le reste de la façade aujourd'hui en moellon, à l'origine destinée à être enduite, est encore peu usité au début du 19e siècle en milieu rural. Les ouvertures en arc segmentaire sont héritées des formes en usage dans l'habitat urbain et noble dès la fin du 17e siècle. La division du rez-de-chaussée en deux pièces habitables et le décor est également d'origine urbaine ; les pièces sont séparées par un couloir limité par des cloisons de bois : les portes d'accès à l'escalier et aux deux pièces sont ornées de losanges, les deux portes d'accès à l'escalier et à la cave sont séparées par un pilastre cannelé à chapiteau composite.
Ce couloir dallé distribue deux pièces identiques : sur chaque pignon, une cheminée engagée en granite (linteau sur sommiers et piédroits droits pour celle de l'est, piédroits chanfreinés pour celle de l'ouest) ; contrairement à l'habitude, l'évier est inséré sous la fenêtre nord de chacune des deux pièces : en effet ces pièces possédait un double éclairage, fait très rare dans l'habitat rural. A l'étage, la pièce est dispose également d'une petite cheminée en pierre adossée au pignon : cependant, cette cheminée n'a jamais servi et l'étage ne semble pas avoir été cloisonné. La présence d'un étage carré non habité est un trait que l'on retrouve souvent dans l'architecture rurale de l'ouest morbihannais au 19e siècle : ce faux-étage est en fait un grenier, généralement non ou peu cloisonné ; il est surmonté d'un comble parfois divisé en deux niveaux de grenier.
Le traitement de l'étable (ou écurie) est identique à celui du logis, à l'exception de l'absence de cave ; cependant, aucune cheminée n'est présente en pignon. Il ne semble pas que l'étable disposait de son propre escalier d'accès au comble : en effet deux portes percés dans le refends à chaque niveau permet la communication entre les deux parties.
La porte reliant logis et écurie au niveau du comble est un remploi de la fin du 16e siècle : en anse de panier moulouré, ses piédroits chanfreinés se terminent par des griffes très soignées. Cette porte, les piédroits chanfreinés de celle du rez-de-chaussée, ceux de la cheminée ouest montrent que comme souvent sur la ria, mais ici très discrètement, on remploie par économie quelques éléments de l'ancien édifice ; la trace d'une reprise dans le mur nord comblant une forme incurvée (ancien escaler en vis ?), peut inciter à y voir une reconstruction in situ, dont seule aurait été conservée une partie du mur nord.
L'ensemble concoure à donner l'illusion de deux logis urbains à étage en alignement, même si la construction sans doute presque contemporaine de l'étable en retour a gâché la vue d'ensemble.
Au sud de la cour, est édifié une petite dépendance en ruine, peut-être initialement voûtée en pierre, un édicule rare qui pourrait être un cellier, dont peu d'exemples sont conservés autour de la ria d'Etel.





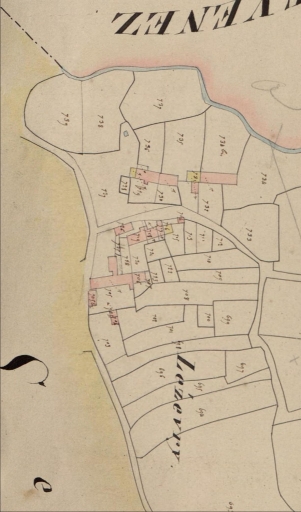























Chargée d'études à l'Inventaire