Autres oeuvres conservées dans l´église : :
NB : Les oeuvres sont décrites selon le plan adopté dans les notices individuelles :
Dénomination : matériau : technique ; dimensions. État de conservation. Inscriptions. Datation. Décor. Numéro d´image.
Une seule oeuvre d´une série ou d´une paire est généralement photographiée ; plusieurs oeuvres sont parfois rassemblées sur la même image ; elles sont décrites de gauche à droite dans les légendes.
Dais n°1 : métal : fondu, doré ; soie (blanche) : satin. Oeuvre déposée. 4e quart 19e siècle. Fig. 3.
Dais n°2 : métal : fondu, doré ; soie (blanche) : satin. Oeuvre déposée. 4e quart 19e siècle. Fig. 4.
Canon d´autel : métal : fondu, doré ; papier : imprimé, polychrome, doré ; 42, 5 h. Oeuvre déposée. Limite 19e 20e siècle. Représentation : Christ ; Evangélistes. Fig. 5.
Claquoir : bois : mouluré, vernis ; 16 l. Oeuvre déposée. Fig. 5.
Série de 6 Chandeliers d´autel : métal : fondu, doré ; 50 h. Oeuvre déposée. 19e siècle. Représentation : représentation végétale. Limite 19e siècle 20e siècle. Fig. 6.
Série de 4 Chandeliers d´église : métal : fondu, doré ; 34,5 h. Deux sont déposés. Deux sont électrifiés. Oeuvre déposée. Limite 19e siècle 20e siècle. Représentation : représentation végétale. Fig. 6.
Paire 1 de Chandeliers d´église : métal : fondu, peint doré ; 64 h. Oeuvre déposée. 19e siècle. Représentation : représentation végétale. Fig. 6.
Paire 2 de Chandeliers d´église : métal : fondu, peint doré ; verre transparent (coloré) : taillé en cabochons ; 41 h. Oeuvre déposée. 19e siècle. Représentation : représentation végétale. Fig. 7.
Porte-luminaire 1 : métal : fondu, doré ; 17,5 l. Oeuvre déposée. Représentation : ornementation végétale. Fig. 8.
Porte-luminaire 2 : métal : fondu, doré ; 37,5 l. Oeuvre déposée. Représentation : ornementation végétale. Fig. 8.
Porte-luminaire 3 : métal : fondu, doré ; 31 l. Il est électrifié. Limite 19e siècle 20e siècle. Représentation : ornementation végétale. Fig. 9.
Croix d´autel 1 : métal : fondu, argenté ; 63 h. 2e moitié 19e siècle. Représentation : Dieu le Père ; le Fils ; Saint Esprit ; angelots ; palmettes. Fig. 10.
Croix d´autel 2 : métal : fondu, argenté ; 56 h. Oeuvre déposée. 2e moitié 19e siècle. Représentation : Agneau immolé ; ornementation végétale. Fig. 10.
Croix d´autel 3 : métal : fondu, doré ; 63 h. Oeuvre déposée. 2e moitié 19e siècle. Représentation : ornementation végétale. 4e quart 19e siècle. Fig. 10.
Croix d´autel 4 : métal : fondu, argenté ; 55 h. 2e moitié 19e siècle. Représentation : ornementation stylisée. Fig. 10.
Pupitre d´autel : bois : ciré ; 57,5 h. Oeuvre déposée. 4e quart 19e siècle. Fig. 11.
Pupitre d´autel-Thabor : métal : fondu, doré, émail, polychrome ; 31 la. Oeuvre déposée. 1er quart 20e siècle. Représentation : I.H.S. ; croix. Fig. 11.
Sonnette liturgique : métal : fondu, chrome ; 18 h. Oeuvre déposée. 4e quart 19e siècle. Représentation : ornementation végétale. Fig. 12.
Vase à fleurs : porcelaine (blanche) : moulée, dorée, peinte, polychrome ; 13 h. Oeuvre déposée ; le vase est cassé. 2e moitié 19 siècle. Représentation : ornementation végétale. Fig. 12.
Vase à fleurs : porcelaine (blanche) : moulée, dorée ; 21 h. Oeuvre déposée ; est fêlé, dorure lacunaire. 2e moitié 19 siècle. Inscription : 456. Fig. 12.
Lanterne du viatique : métal : fondu, doré ; verre transparent : découpé ; 24,5 h. 2e quart 20e siècle. Fig. 13.
Plateau de communion : métal : matricé ; 23 l. Milieu 20e siècle. Fig. 13
Ampoule à huiles saintes : métal : fondu, argenté, gravé ; 5,2 h. La croix du couvercle est manquante. Oeuvre déposée. Limite 19e siècle 20e siècle. Inscription : SCH. Fig. 13.
Ampoule à huiles saintes : métal : fondu, argenté, gravé ; bois : mouluré, vernis ; h. Oeuvre déposée. Inscription gravée sur la boîte : O.S. / S.C. / O.I. Fig. 13.
Coquille de baptême : métal : fondu, argenté ; 9,5 h. Représentation : en forme de coquillage. Fig. 13.
Paire de Encensoir : métal : fondu, argenté ; 24,5 h. L´argenture est lacunaire sur le premier, le second n´est pas argenté. Un seul est déposé. 2e moitié 19e siècle. Fig. 14.
Croix-Reliquaire : bois, mouluré, peint ; argent ; fondu, métal : argenté ; 53,5 h. Oeuvre déposée ; oeuvre remaniée au milieu 20e siècle. 2e moitié 19e siècle. Fig. 14.
Croix de procession n°2 : métal : fondu, argent, doré ; 103 h. 2e moitié 19e siècle. Représentation : angelots ; rayons ; palmettes ; urnes ; coeurs enflammés. Fig. 15.
Paire de Croix de procession n°3 : métal : fondu, doré, peint polychrome ; 67 h. Oeuvre déposée. Limite 19e siècle 20e siècle. Représentation : ornementation végétale. Fig. 15.
Paire de Croix de procession n°4 : métal : fondu, argenté, doré, polychrome ; 51,5 h. Oeuvre déposée. Limite 19e siècle 20e siècle. Représentation : ornementation végétale. Fig. 15.
Ensemble de 4 Lanternes de procession : métal : fondu, doré ; verre : taillé ; bois : tourné, vernis ; 60h. Oeuvre déposée. Limite 19e siècle 20e siècle. Représentation : lancettes. Fig. 16.
Garniture de dais : soie (jaune) : tissu façonné, application sur textile ; fil métal : doré, argenté. Oeuvre déposée ; le tissu d´un des pans est coupé. 2e moitié 19e siècle. Représentation : agneau aux sept sceaux ; pélican mystique ; triangle ; arche d´alliance. Fig. 17, 18, 19, 20, 21, 22.
Conopée n°1 : soie (jaune) : drap d´or, application sur textile ; fil métal : doré. Oeuvre déposée. 4e quart 19e siècle. Représentation : ornementation végétale. Fig. 23.
Conopée n°2 : soie (violette) : faille française, application sur textile, adjonction d´éléments ; fil métal : doré. Oeuvre déposée. Limite 19e siècle 20e siècle. Fig. 23.
Conopée n°3 : soie (verte) : satin, application sur textile, adjonction d´éléments ; fil métal : doré. Oeuvre déposée. Représentation : agneau aux sept sceaux ; hermines. Limite 19e siècle 20e siècle. Fig. 23.
Conopée n°4 : soie (rouge) : satin, application sur textile, adjonction d´éléments ; fil métal : doré. Oeuvre déposée. Représentation : agneau aux sept sceaux. Limite 19e siècle 20e siècle. Fig. 23.
Conopée n°5 : soie (jaune) : drap d´or, application sur textile, adjonction d´éléments ; fil métal : doré. Oeuvre déposée. Représentation : Pélican mystique. Limite 19e siècle 20e siècle. Fig. 23.
Conopée n°6 : soie (verte) : tissu façonné, application sur textile, adjonction d´éléments ; fil métal : doré. Oeuvre déposée. Représentation : I.H.S..4e quart 19e siècle. Fig. 23.
Pale n°1 : toile (blanche) : coton, dentelle. Oeuvre déposée. Limite 19e siècle 20e siècle. Représentation : blé ; vigne ; roseau ; ostensoir ; croix. Fig. 24.
Pale n°2 : toile (blanche) : coton, dentelle. Oeuvre déposée. Limite 19e siècle 20e siècle. Représentation : croix. Fig. 24.
Pavillon de ciboire soie (blanche) : satin, application sur textile, peint polychrome. Oeuvre déposée. 1er quart 20e siècle. Représentation : blé ; I.H.S. Fig. 25.
Bourse de viatique : soie (blanche) : tissu façonné, application sur textile. Oeuvre déposée. 1er quart 20e siècle. Fig. 25.
Voile d´exposition n°1 soie (blanche) : velours uni, peint polychrome, application sur textile ; fil métal : doré. Oeuvre déposée. 2e quart 20e siècle, vers 1930 siècle. Représentation : croix ; ornementation végétale ; roses. Fig. 26.
Voile d´exposition 2 soie (blanche) : faille française, moirée, brodée polychrome, application sur textile ; fil métal : doré. Oeuvre déposée. 2e quart 20e siècle. Représentation : blé ; ornementation végétale ; agneau aux sept sceaux. Fig. 26.
3 Aubes : toile (blanche) : coton, dentelle. Oeuvre déposée. 19e siècle. Représentation : ornementation végétale. Fig. 27.
Chape blanche : soie (blanche) : faille française, application sur textile ; fil métal : doré. Oeuvre déposée ; le décor a été rapporté sur le chaperon lors d´une restauration.
1er quart 20e siècle. Représentation : alpha oméga ; chrisme ; croix. Fig. 28.
Chape dorée : soie (jaune) : drap d´or, application sur textile, adjonction d´éléments ; fil métal : doré. Oeuvre déposée. 4e quart 19e siècle. Représentation : ornementation végétale ; le Bon Pasteur ; croix. Fig. 29.
Chape noire : soie (noire) : velours uni, application sur textile, adjonction d´éléments ; fil métal : argenté. Oeuvre déposée. Limite 19e siècle 20e siècle. Représentation : croix ; couronne ; I.H.S. ; rayons. Fig. 30.
Ornement blanc 2 : Chasuble, bourse de corporal, manipule, voile de calice : soie (blanche) : faille française, tissu façonné, application sur textile ; fil métal : doré. Oeuvre déposée. 2e quart 20e siècle. Représentation : I.H.S. ; ornementation stylisée. Fig. 31.
Ornement blanc 3 : Chasuble, manipule : soie (blanche) : faille française, moirée, application sur textile ; fil métal : doré. Oeuvre déposée ; le tissu de devant est très usé. 2e quart 20e siècle. Représentation : I.H.S. ; blé ; ornementation végétale. Fig. 31.
Ornement doré 1 : Chasuble, bourse de corporal, voile de calice : soie (jaune) : drap d´or, application sur textile, brodé polychrome. Oeuvre déposée. Limite 19e siècle 20e siècle. Représentation : fleurs de lys ; croix ; ornementation stylisée. Fig. 32.
Ornement doré 2 : Chasuble, manipule : soie (jaune) : drap d´or, application sur textile, adjonction d´ éléments. Oeuvre déposée. Limite 19e siècle 20e siècle. Représentation : agneau aux sept sceaux ; ornementation végétale Fig. 32.
Ornement noir 2 : Chasuble, bourse de corporal, étole, manipule, voile de calice : soie (noire) : velours uni, brodé polychrome, application sur textile ; fil métal : argenté. Oeuvre déposée. Limite 19e siècle 20esiècle. Représentation : I.H.S. ; ornementation stylisée. Fig. 33.
Ornement rouge 1 : Chasuble, bourse de corporal, manipule, voile de calice : soie (rouge) : velours uni, application sur textile ; fil métal : doré. Oeuvre déposée. Limite 19e siècle 20e siècle. Représentation : I.H.S. ; blé ; ornementation végétale. Fig. 34.
Ornement rouge 2 : Chasuble, bourse de corporal, étole, manipule, voile de calice : soie (rouge) : satin, application sur textile ; Oeuvre déposée. Limite 19e siècle 20e siècle. Représentation : I.H.S. ; couronne ; ornementation végétale. Fig. 34.
Ornement vert 1 : Chasuble : soie (verte) : gros de Tours, tapisserie au point, application sur textile. Oeuvre déposée. Limite 19e siècle 20e siècle. Représentation : I.H.S. ; croix. Fig. 35.
Ornement vert 2 : Chasuble, bourse de corporal, étole, manipule, voile de calice : soie (violette) : velours uni, application sur textile, adjonction d´éléments ; fil métal : doré. Oeuvre déposée. Limite 19e siècle 20e siècle. Représentation : I.H.S. ; blé ; ornementation stylisée. Fig. 35.
Ornement violet 1 : Chasuble, bourse de corporal, voile de calice, manipule : soie (violette) : tissu façonné, application sur textile ; fil métal : doré. Oeuvre déposée. siècle. Représentation : I.H.S. ; ornementation végétale. Fig. 36.
Ornement violet 2 : Chasuble : soie (violette) : tissu façonné, application sur textile ; fil métal : doré. Oeuvre déposée ; Oeuvre remontée avec une croix devant. 1ère moitié 20e siècle. Représentation : I.H.S. ; ornementation végétale. Fig. 36.
Étole pastorale 1 : soie (rouge) : velours uni, application sur textile ; fil métal : doré. Oeuvre déposée. Limite 19e siècle 20e siècle. Représentation : croix ; blé ; vigne. Fig. 37.
Étole pastorale 2 : soie (verte) : velours uni, application sur textile ; fil métal : doré. Oeuvre déposée. Limite 19e siècle 20e siècle. Représentation : croix ; blé ; vigne. Fig. 37.
Étole pastorale 3 : toile (support) : tapisserie au point, application sur textile. Oeuvre déposée. Limite 19e siècle 20e siècle. Représentation : croix. Fig. 37.
Étole pastorale 4 : soie (noire) : velours uni, application sur textile ; fil métal : doré. Oeuvre déposée. Limite 19e siècle 20e siècle. Représentation : ornementation végétale. Fig. 38.
Étole pastorale 5 : soie (noire) : velours uni, brodé, application sur textile. Oeuvre déposée. Limite 19e siècle 20e siècle. Représentation : ornementation végétale. Fig. 38.
Étole pastorale 6 : soie (jaune) : drap d´or, brodé polychrome, application sur textile. Oeuvre déposée. Limite 19e siècle 20e siècle. Représentation : ornementation végétale. Fig. 38.
Étole pastorale reversible 1 : soie (violette, blanche) : velours uni, application sur textile, brodé polychrome ; fil métal : doré. Oeuvre déposée. 1er quart 20e siècle. Représentation : croix ; blé ; vigne. Fig. 39.
Étole pastorale réversible 2 : soie (rouge, verte) : tissu façonné, application sur textile ; fil métal : doré. Oeuvre déposée. 4e quart 19e siècle. Représentation : croix. Fig. 39.
Voile huméral 1 : soie (jaune) : drap d´or, application sur textile, adjonction d´éléments ; fil métal : doré. Oeuvre déposée. 4e quart 19e siècle. Représentation : I.H.S. ; ornementation végétale. Fig. 40.
Statue : Saint Joseph et l´Enfant : plâtre : moulé, peint, polychrome, peint doré, peint au pochoir ; 64 h. Oeuvre déposée. 1er quart 20e siècle. Fig. 41.
Statue : l´Enfant Jésus : plâtre : moulé, peint, polychrome, peint doré ; 75 h. Oeuvre déposée ; 1er quart 20e siècle. Fig. 42.
Statue : Immaculée Conception : bois : doré, peint, polychrome ; 82 h. Oeuvre déposée ; les mains et les pieds ont été repeints. 2e moitié 19e siècle. Fig. 43.
Crèche : plâtre : moulé, peint, polychrome, peint doré ; 44 h. 20e siècle. Fig. 44.




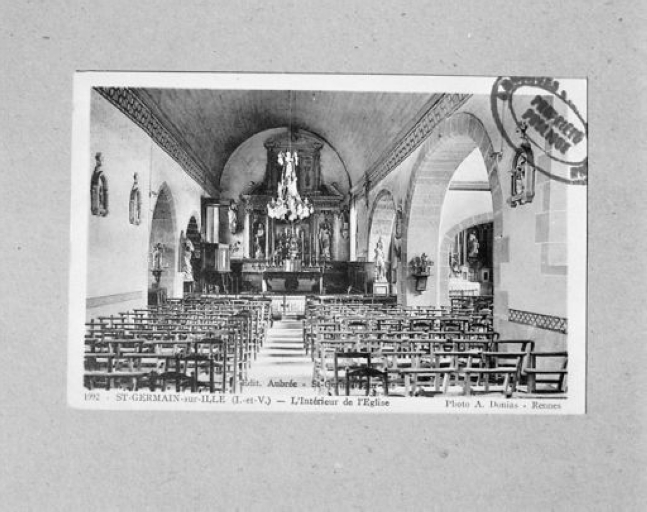














































Chargée d'études d'Inventaire au Conseil Régional de Bretagne, Inventaire du patrimoine.