D´après Bernard Tanguy, un monastère, mentionné dès 1050, serait à l´origine d´une paroisse dont on trouve la mention « monasteriolum sancti Taiaci », puis « locus Thadei » ou encore « Saint Te » (appellation locale). La paroisse de Lothéa, sans véritable noyau urbain, rattachée à Quimperlé en 1791, occupait une surface d´environ 1800 hectares dont une partie importante correspondait à l´ancienne forêt royale de Carnoët. La nef séparée du bas-côté sud par des piles circulaires portant des arcs brisés, la chapelle seigneuriale au sud, les fonts baptismaux et peut-être le petit porche sud, remontaient au 16e siècle. Le massif occidental et le clocher semblaient dater du 17e siècle. On signale la sépulture d´un prêtre, Cariou, recteur de Lothéa, mort en 1691. Le village et la chapelle figurent, d´une manière schématisée, sur un document de 1731. L´édifice, progressivement abandonné, est en ruine en 1960. La reconstruction totale, d'après les plans de l'architecte Le Tenneur et achevée en 1995, a été menée à terme avec l´aide d´une association locale. La croix, remaniée, porte les dates de 1912 et 1938.
- inventaire topographique, Quimperlé
-
Scheinkmann XavierScheinkmann XavierCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.
Dossier non géolocalisé
-
Aire d'étude et canton
Quimperlé - Quimperlé
-
Commune
Quimperlé
-
Lieu-dit
Lothéa
-
Cadastre
1981
BT
120
-
Dénominationschapelle
-
Vocablessaint Théa
-
Parties constituantes non étudiéesenclos, croix monumentale
-
Période(s)
- Principale : 4e quart 20e siècle
- Secondaire : 16e siècle
- Secondaire : 17e siècle
-
Dates
- 1691, daté par travaux historiques
- 1912, daté par source
- 1938, daté par source
- 1995, daté par source
-
Auteur(s)
- Auteur : architecte attribution par travaux historiques
La flèche carrée servant de chambre de cloche est couverte d'un toit en pavillon. Nef et porche sud couverts de toits à longs pans.
-
Murs
- granite
- schiste
- moellon
-
Toitsardoise
-
Couvrements
- charpente en bois apparente
-
Couvertures
- toit à longs pans
- flèche carrée
- toit en pavillon
-
État de conservationreconstruit à l'identique
-
Statut de la propriétépropriété de la commune
L'édifice a été reconstruit en grande partie à l'identique, mais on constate quelques différences entre le dessin de Louis Le Guennec (vers 1930) et l´état actuel, notamment en ce qui concerne le porche sud et la couverture de la flèche. Contrairement au clocher, plus tardif et probablement remanié à plusieurs reprises, le choeur à chevet plat et l´ancienne chapelle seigneuriale aménagée au sud, dispositifs comparables à ceux de la chapelle de la Madeleine à Mellac, confèrent à l´édifice une silhouette typiquement cornouaillaise.

- (c) Inventaire général, ADAGP
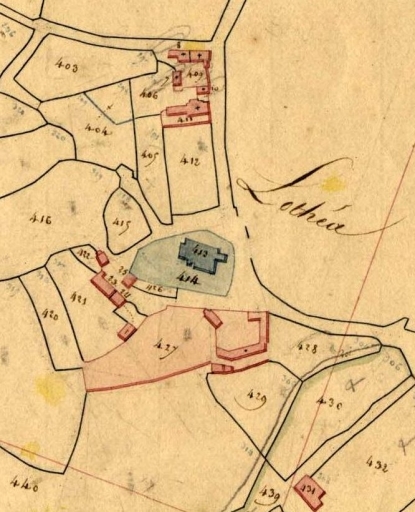
- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP
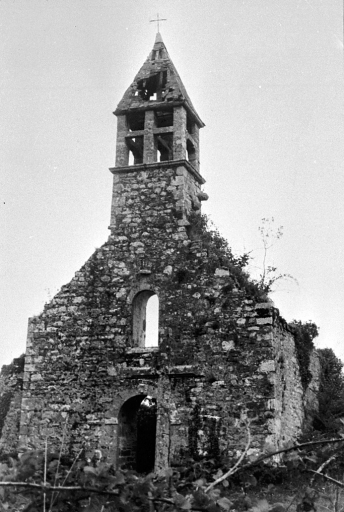
- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP
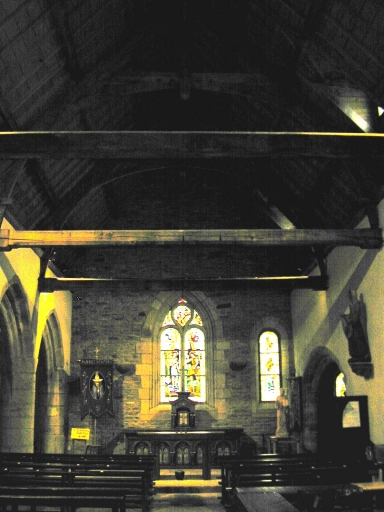
- (c) Inventaire général, ADAGP
Documents d'archives
-
A.N. Finistère, N IV. Plan géométrique de la forêt royale de Carnoët, par Jean-Baptiste Robert, géomètre, 1731.
-
A.D. Finistère, 3 P 292. Cadastre de 1824, section C2 dite de Québlen.
-
A.D. Finistère, 34 J 145. Fonds Le Guennec.
-
A.D. Finistère, 1 Fi. Cartes postales.
Bibliographie
-
Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)
COUFFON, René, LE BARS, Alfred. Diocèse de Quimper et de Léon. Nouveau répertoire des églises et chapelles. Quimper : Association Diocésaine, 1988.
p. 360 -
TANGUY, Bernard. Dictionnaire des noms de communes, trèves et paroisses du Finistère. Douarnenez : Ar-Men - Le Chasse-Marée, 1990.
p. 186






