Situation, composition générale et description :
Construit à l'origine sur une parcelle traversante, l'hôtel, tourné vers la rue de la Palestine et le jardin du Thabor, disposait d'un grand jardin à l'arrière ; ce dernier fut divisé ultérieurement. Élevé d'un étage carré sur rez-de-chaussée surélevé et sous-sol et de deux étages de comble, l'édifice adopte un plan en équerre, présentant une aile de pavillon en saillie alignée sur la rue. En avant de la partie droite de la façade, en retrait, une grille reposant sur un soubassement de granite délimite une petite cour d'entrée et marque l'emprise du bâtiment. Elle semble être dédiée au perron de granit qui mène sous un porche dans-oeuvre, entrée principale de l'hôtel, ainsi qu'à l'élégant oriel en légère saillie signalant l'emplacement de l'escalier principal.
Distribution
Si le parti général de distribution est perceptible par une première lecture de façade, le détail originel de l'emplacement des pièces n'est malheureusement pas totalement connu. L'entrée débouche sur un vaste hall ouvrant, sur la gauche, sur le grand salon placé dans le pavillon en saillie sur la rue et sur une salle à manger du côté du jardin, agrandie par un bow-window. Deux passe-plats avec monte-charge, placés de part et d'autre de la grande cheminée, témoignent de l'emplacement originel des cuisines en sous-sol. Salon et salle à manger, largement ouverts l'un sur l'autre, pouvaient vraisemblablement se diviser grâce à des cloisons de boiserie. Une troisième pièce, desservie depuis le hall et communiquant avec la salle à manger, correspond sans doute à un espace de réception plus intime, peut-être un fumoir, une bibliothèque ou une petite salle à manger. Une série de placards de boiserie est ménagée dans l'épaisseur des murs. Sur la droite, se trouve encore une petite pièce du côté du jardin, à laquelle fut annexée une cuisine en retour d'équerre dans les années soixante.
Le hall d'entrée donne accès, au-delà d'un arc surbaissé, au départ de l'escalier principal, et à celui masqué par une porte, de descente vers les caves. Ce dernier est également desservi au niveau de la rue par une porte de service.
Aux étages, un couloir central distribue ce qui devait être une série de chambres ; côté rue, la pièce centrale renfermait une salle de bains et des toilettes séparées, tandis que du côté du jardin, une pièce se trouve agrandie par une échaugette en saillie. L'actuel dernier niveau de comble devait être un simple grenier, l'escalier qui en permet l'accès n'ayant été construit que récemment.
Élévation :
Construite dans un appareil soigné de tuffeau, au-dessus d'un soubassement de granite, la façade antérieure de l'hôtel, inspirée par l'architecture du 16e siècle, se caractérise par une recherche d'équilibre dans l'asymétrie et se compose de trois travées de taille décroissante (de gauche à droite). Au corps massif en saillie, régulièrement ouvert sur la rue par deux baies rectangulaires et une lucarne richement ornée s'inscrivant dans un toit en pavillon, répond la masse du corps central, légèrement plus large, marquée par des ouvertures irrégulières et un décor architectural raffiné et complexe. Une petite échaugette dans l'angle, citation miniature d'un passage médiéval, relie ces deux volumes principaux. La travée centrale, principalement dévolue au porche dans-oeuvre, présente une gradation de ses percements suivant les niveaux (porche, fenêtre à meneaux, petite lucarne). Le dessin du porche, ouvert sous un arc en plein cintre à clef pendante, cantonné de pilastres plats et d'écoinçons, et couronné d'une petite ouverture surmontée d'un fronton triangulaire, prend les accents de la Renaissance maniériste (forte saillie des tailloirs, modillons dans les angles du vide supérieur) en jouant des contrastes d'ombre et de lumière.
La travée droite est occupée par le volume vertical de l'oriel en légère saillie recevant l'escalier, dont le couronnement à l'impériale en pierre se rattache à la toiture par une fausse balustrade placée sous la corniche, créant un jeu de trompe l'oeil d'une grande originalité.
Les parties latérales hautes de la façade sont ornées de motifs sculptés plaqués (têtes d'hommes sur les piédroits de la lucarne, chutes de fruits, volutes et guirlandes de feuillage, décor de cuir découpé) qui viennent enrichir un décor architectural savant (fronton, larmiers) ; un écusson armorié placé sur l'angle du bâtiment évoque les palais italiens. Les éléments se répondent imperceptiblement pour créer une oeuvre unifiée.
De hautes toitures d'ardoise, dont il faut restituer le volume original en faisant abstraction de la série de lucarnes percées au dernier niveau, viennent couronner l'édifice.
Un contraste frappant nait de la comparaison entre la façade principale et celle sur jardin qui a été traitée avec la plus grande simplicité (murs enduits rehaussés d'arcs et de bandeaux de briques rouges), où la seule fantaisie est apportée par une échaugette en pan de bois avec remplissage de brique au niveau du premier étage. L'édifice se tourne ostensiblement vers le jardin du Thabor avec lequel il établit un dialogue.
Décor intérieur :
Du décor intérieur, dont on imagine encore la grande richesse, ne subsiste que quelques éléments. Dans le hall d'entrée, un tapis de mosaïque de marbre polychrome peut vraisemblablement être attribué à l'atelier d'Isidore Odorico père. Les murs sont garnis d'un ensemble de lambris de hauteur, en chêne, dont les panneaux rectangulaires moulurés s'ornent de médaillons et de têtes sculptés. Ce décor est complété par un plafond compartimenté, également en bois, aux motifs d'entrelacs géométriques, et d'un départ d'escalier sculpté de motifs végétaux. Le salon est également garni de panneaux rectangulaires de boiseries, aujourd'hui uniformément repeints, mais qui devaient renfermer un ensemble de peintures ornementales à décor de fleurs ; un motif de coquilles et de fleurons orne le plafond. La salle à manger conserve en revanche une cheminée monumentale dont le manteau présente les armoiries des commanditaires timbrées d'une couronne comtale. Elles s'inscrivent dans un cadre mouluré surmonté d'une tête en haut relief, au centre d'un décor architecturé ; l'ensemble est rehaussé de peinture polychrome. L'ornementation, comme celle du hall, fait encore de nombreux emprunts à la Renaissance de l'École de Fontainebleau.
Conclusion :
Oeuvre de maturité, l'hôtel de la Villeaucomte illustre avec brio certaines caractéristiques de l'architecture domestique de Frédéric Jobbé-Duval. Il adopte les dispositions traditionnelles de l'hôtel urbain entre cour et jardin, une volumétrie fortement accentuée (pavillon en saillie, couvrements) exprimant la partition tripartite de l'espace intérieur, une façade arrière très simple, autant d'éléments récurrents que l'on peut, par exemple, retrouver au 21, rue de Brizeux construit quelques dix ans auparavant. Pourtant, l'architecte a ici abandonné la polychromie à laquelle il était habitué pour laisser place au jeu de la lumière sur les vides et les pleins, et mettre en valeur un jeu subtil de références tirées de la Renaissance maniériste ou du vocabulaire d'un Philibert Delorme. La cohérence de l'édifice, de son décor intérieur et extérieur, témoignent de la recherche d'une oeuvre d'art total, ou les citations à une architecture savante sont une des formes de l'Art Nouveau.















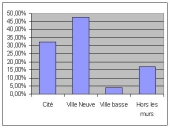

Photographe à l'Inventaire