Leclerc 6E 856. Procès-verbal de la grande maison du Père Eternel appartenant à Janne de Quélen le 3 Février 1670.
Le troisièsme jour de février de l´an mil six centz soixante dix à une heure de l´après-midi devant nous nottaires royaux héréditaires de la cour et sénéchaussée de Vennes et par icelle a comparu en personne Messire François de Trenegat seigneur de Lomaria Le Hemen Kerberuet Limoge Kervallet La Sauldraye Couetregarff La Forest Rué conseiller du roy au parlement de Bretaigne demeurant en sa maison noble de Limoges près vennes parouesse de Saint Patern faisant et agissant pour damoiselle Janne de Quélen dame de Monteville demeurant en la ville de Rennes lequel faisant pour la dite dame de Monteville et au moien du contrat du neuffiesme novembre dernier passé par cette cour devant Le Clerc l´un des nottaires soubz signants par lequel elle a acquis de monsieur Me François Le Meilleur seigneur du Parun conseiller gardesceau au présidial duquel mari et procureur de droit de dame Thérèze Fruneau sa compaigne, noble homme Joseph Fruneau sieur de la Grignonnerye, noble homme Guillaume Bigaré Sieur de Canno père et garde naturel de nobles gentz Vincent et Joseph Bigarré et de Dlle Marye Bigaré ses enfants de son mariage avecque déffuncte dame Marye Fruneau Damoiselle Marguerite Bigarré noble homme François Bigaré, noble homme Jacques Bigarré une moityé du tout d´une grande maison sittuée en la rue St Jullien sur le port de Vennes proche la chapelle Sainct Jullien et couvent des religieux Carmes Deschaussés du dit Vennes de la cour et jardin derrière et au boult de la dite maison et cabinet estant au dit jardin une moityé de l´issue vendu de la dite maison comme elle se contient et poursuilt et où demeure le dit Sieur de Canno pour la tenir et relever du fief des régaires à Vennes et vandue pour la somme de trois mille huit cens livres tournois comme plus au loings porte le dit contrat et par lequel contrat pour induire la dite dame de Monteville en la réelle possession et jouissance de la dite moytié de maison cour jardin issue devant et dépendances et assisté au prcès-verbal de l´estat des dites chosses et réparations nécéssaires les dits Sr et Dlle vandeurs avoient institué à leur procès maistre François Le General demeurant au dit Vennes lequel a aussi comparu et pour aux fins de son dit pouvoir porter en au du contrat donner la dite possession réelle et asister au dit procès et à la dite fin nous estant transportez à la dite maison le dit Le Général a avecque nous faict entrer le dit seigneur de Lomaria pour la dite damoiselle de Monteville en la possession réelle des dites moytié de maison cour jardin issue devant et dépendances pour y estre allé et venu et fait tous actes pour la ditte possession prendre et acquérir ce que nous avons faict sans aucune opposition et le dit seigneur de Lomaria requis a esté vacqué au dit procès verbal en présence du dit Le Général présent et le dit seigneur de Lomaria a faict comparoir pour expertz François Cosnier Me architecte Pierre le Francq Me Masson Jan Phelipot et Jan Bellin Me charpentier Jullien Tetiot et Mathurin Pereul couvreur Jan Mollay et François Garderel terrasseurs Jullien de la Chaussonnière et François Le Garo Me vitriers tous estants au dit Vennes qui ont comparu et promys de s´y comporter fidellement et y a esté procédé comme ensuit.
Et premier au département de la dite maison où demeuroit le dit Sieur de Canno et dernièrement acquis par la demoiselle de Monteville.
Le dit Cosnier et Le Francq nous ont montré et faict voir que les deux cheminées qui sont aux deux chambres basses du dit département de maison et prochainne de la merre les deux contrecoeurs ou tredos d´icelles cheminée sont souplombées en dedans ce qui ce qui cause que les fumées sont incommode et ne peuvent en l´estat servir et dict que tout les refaire à neuff il fauldra et est nécéssaire de démollir les contrecoeurs et aussi les housses et languettes des deux cheminées et aussi des cheminées qui sont en mesme conduitte au second estaige et les refaire à chau et sable et pour fournir les matériaux nécéssaires se servir et dispozer de ce qui s´en trouvera de bons et pour l´oeuvre de main et refaire les teste des dites cheminées de tufeau ainsi qu´elles sont à présent il coustera la somme de quatre cens livres et qu´il est nécéssaire d´y travailler de jour à aultre pour pouvoir demeurer en la maison.
Les charpentiers ont en nostre présence veu et vesitté le plancher de la chambre basse du dit département proche la mer lequel ils ont dit que à cause qu´il est porté sur la terre estre pour la plupart des planches pourye et que est nécéssaire de la changer et y en faire un neuf pour lequel faire fournir les planches de bois de chesne le chevron cloux et pour l´oeuvr´e de main qu´il coustera la somme de cent cinquante livres.
Les dits charpentiers ont fait voir que la porte de devant du dit département il y avoit un huisset qui c´est trouvé rompu et en deux pièces et ont dict que pour y en meptre un neuff avec ses bandes de fer courouil qu´il coustera la somme de neuff livres.
Et la closture de planches de sap qui est à la dite chambre au proche la porte d´entrée la planche qui sert de batan à la dite porte est cassée et ont dict que est nécéssaire de la changer et y en meptre une aultre de dix piedz de hault et de large un piedz et pour la fournir et oeuvre de main et pour quelque aultre boutz de planches qu´il sera nécéssaire de meptre en démollissant et replaçant les chosses qu´il coustera quatre livres dix sols.
Les dits vitriers ont dict que est nécéssaire de relever cinq paneaux des victres qui sont à la dite chambre proche la mer pour y meptre des estaches le dit fourbu et y fournir sept pièces qui y manquent ce qui coustera soixante quatre sols.
A l´autre chambre au boulz les dits vitriers nous ont faict voir que à la fenestre y estante il y manque deux panneaux de viltre de trois pieds en carré chacun qui cousteront mys en place quarante huit sols.
Les dits charpentiers nous ont faict voir que dans la dite chambre basse qui sert de cuizine est pavée d´un pavé de pierre de cailloux et quy est inégalle et pour s´en servir commodement ont dict que est nécéssaire de plancher de bois de chesne la dite chambre basse et coustera pour fournir les planches chevrons et cloux et pour l´oeuvre de main la somme de cent cinquante livres.
Les dits terrasseurs ayant veu et visitté le dit département du dit Sr de Canno quant aux deux chambres basses et terrasses qui y sont ont dict qu´il est nécéssaire de garnir aux dites chambres basses de chau et sable en plusieurs endoitz et ensuilte de blanchir le tout des dites deux chambres et la gallerye passaige entre deux qui rend à l´escallier pour monter en hault et pour fournir les matériaux et oeuvre de main qu´il coustera la somme de trante livres.
Les dits charpentiers nous ont monstré et dit que la porte proche l´escallier du dit département pour sortir en la cour est fort vieille et qu´il reste y faire quelques réparations et y meptre une cerrure et locquetier qui cousteront six livres.
Les dits charpentiers ayant veu et visitté la chapseulle qui est au bas de la clouaizon de terrasse quy sépare les deux départements de la dite maison ont faict voir et dict qu´elle est pourye en la plupart qu´il est nécéssaire de la changer y en meptre une neuve en sa place de dix huit pieds de long et dearré six poulces et pour la changer démollir la ditte terrasse les coulompnes pour le faire non compris la terrasse ont dit qu´il coustera en disopzant de la vieille chapseulle la somme de vingts livres.
Et les terrasseurs pour refaire la terrasse de la dite clouaizon la garnir et blanchir fournir les matériaux nécéssaires ont dict qu´il coustera la somme de vingt livres se servant et dispozant des vieux matériaux.
Et tous les dits expertz ont dit que pour l´utillitté de la dite maison et surté des deux départements d´icelle et mesme qu´ont il ni auroit qu´un seul propriettaire il seroit et est nécéssaire de faire une muraille de refante au lieu où est la dite closture et terrasse depuis le bas jusques en hault et dans la dite muraille y faire des portes à taille de communication et pour les fair fournir les matéraiux pierres chau et sable et l´oeuvre de main qui coustera la somme de trois cens livres.
Les dits charpentiers ayant visitté l´escallier de la dite maison et département où estoit le dit Sieur de Canno ont dit que le dit escallier à vis est tout à fait incommode de la sorte les marches trop haultes et qu´il est fort ancien et est nécéssaire de la reffaire à neuff soit au dit lieu où il est ou en un aultre endroit de la dite maison et en le refaisant qu´il soit à deux noiaux de quatre piedz de longueur les marches de largeur un piedz et de haulteur de marche environ cinq poulces et selon la haulteur des estaiges, pour le changer et faire à neuff qu´il coustera pour fournir tous les bois dispozera du vieux bois et pour l´oeuvre de main qui coustera la somme de trois cens livres.
Et la chambre haulte du dit département qui est la chambre vers la mer, les terrasseurs nous ont dit qu´il est nécéssaire de regarnir en quelques endroitz et de blanchir le tout de la dite chambre ce qui coustera pour matériaux et oeuvre de main la somme de douze livres.
Les viltriers ont dict qu´il est nécéssaire relever les huit paneaux de viltres qui sont aux deux fenestres de la dite chambre pour les fourbis y meptre des ataches et huit pièces de ver avecques une gaulle de fer pour tout quoy il coustera soixante dix sols.
A la porte de la dite chambre les dits charpentiers nous ont faict qu´il n´y a de cerrure ainsy dict que pour y en meptre une il en coustera soixante dix sols.
A l´autre chambre au boult et du mesme département du dit Sr de Canno, les dits charpentiers ont dict que à la porte de la dite chambre il n´y a de cerrure et pour y en meptre une qu´il coustera soixante dix sols.
A la porte du transport des dites chambres qui est sur l´escallier il n´y a de carré ny porte de bois et pour y en faire une qu´ils disent estre nécéssaire et la fournir avecque sa ferrure et cerrure qu´il coustera la somme de vingt quatre livres tournois.
Tous les dits expertz nous ont dict que dans la dite chambre l´on a cy devant mys de la morue et qu´il y en a en tant que la dite chambre en est présentement infectée et sans sy mal que l´on ny peut demeurer sans avoir l´odeur puanteur de l´infection de la dite morue et laquelle puanteur ne se peut oster ny empescher que en démollissant en entier le tout la place de terrasse et tuilles qui est à la dite chambre.
Laquelle place et tuille les dits terrasseurs nous ont faict voir estre ruisné et dict que pour la ruisne pour les dites causes cy dessus il est nécéssaire de la refaire à neuff et les dits charpentiers que atendu le dit changement qu´il sera plus à propos du plancher la dite chambre de bois de chesne et pour fournir les planches clous et chevrons qui seront pozés sur places de terrasses et oeuvre de main il coustera la somme de deux cent livres.
Et les terrasseurs pour faire la place de terrasse au dessoubz et fournir le bavasseau foin terre et oeuvre de main et chau pour contretaller et blanchir par dessoubz qu´il coustera la somme de cinquante livres.
Les dits vitriers ont dict et fait voir qu´il y a quatre paneaux de viltre à la fenestre de la dite chambre qu´il reste relever fourbis et meptre des estaiges et dix pièces de ver quy y manquent tout quoy ils ont estimé à soixante sols.
A l´escallier du dit département nous ont faict voir qu´il y a quatre panneaux de viltre qu´il fault relever et meptre en plomb ce qui cause qu´il fauldra en fournir la valleur de deux tout quoy ils ont dict estimer à la somme de quatre livres.
La Gallerye au derrière et un apentis contre la dite maison.
Les dicts charpentiers ont faict voir que la dite gallerye est battye de bois et terrasse et couverte et tuitellée d´ardoizes laquelle ils ont mesurée et trouvée contenir trante piedz de longueur et six piedz et demi de francq de largeur laquelle est sur pands et pilliers de bois lesquels boisaige fera sur douze pieds de boult de la ditte gallerye ils disent qu´ils sont pourys et qu´il est requis de la refaire et bastir de neuff estante par panchée afessée et crevassée et comme la dite gallerye est pour le service des lieux communs de la dite maison ont dit qu´il est nécéssaire de la refaire et bastir à neuff pour tous les bois de charpente qui compozent la dite gallerye fournir et rendre à plasse ont dict qu´il coustera la somme de quatre cens livres dispozant des vieux matériaux dans la haulteur des estaiges comme elle est après.
Les terrasseurs ont dict que il sera nécéssaire de faire les terrasses et places de la dite gallerye qui feront deux estaiges et les greniers au-dessus et pour fournir tous matériaux garnir tuiller et blanchir qu´il coustera la somme de cens livres se servant des vieux matériaux.
Les couvreurs pour refaire le tuitellaige et couverture de la ditte gallerye en la mesme grandeur qu´elle est pour fournir ardoize cloux lattes cheville chevron et chaupour garnir et l´oeuvre de main et servir des vieux matériaux il coustera la somme de cens cinquante livres.
Les terrasseurs ont dict que reste garnir en quelques endroitz l´escallier et aux dits greniers du dit département et blanchir où il l´a esté et meptre des tuilles et pour fournir matériaux et oeuvre de main il coustera la somme de quinze livres.
Au grenier du dit département vers la mer Le dit Cosnier et Le Francq nous ont montré une cheminée dans le pignon donnant vers la mer où il n´y a de manteau ny housse et dict qu´il est nécéssaire d´y meptre un manteau de pierre et faire la housse de la dite cheminée et goinsbler en deux endroitz sur la longère vers midi et pour fournir les matériaux et oeuvre de main qu´il coustera la somme de trente livres.
Les couvreurs ayant visitté la couverture de la dite maison au dict département ont dict qu´il y reste des pierres faillantes boutz de latte et pour la réparer fournir matériaux qu´il coustera la somme de dix livres.
A la fenestre quy est au pignon au dit grenier il n´y a qu´un petit brallye et pour y faire une fenestre les dits charpentiers ont dict qu´il coustera la somme de soixante dix sols compris la serrure.
Aux portes de l´entrée des greniers et à une des portes du dit grenier il y a de vieilles serrures sans clefs et ont dict les dits charpentiers qu´il est nécéssaire d´y en meptre de meme qui coustera mise en place six livres.
Au pigeonnier au dessus de l´escalier nous ont faict voir que la porte est desgondée et qu´il reste la remeptre à place et coustera la somme de trente sols.
Dans l´autre département et moytié de maison acquis du monsieur du Parun conseiller par aultre contract et requérant le dit seigneur de Lomaria avons aussi vacqué au procès-verbal d´icellui.
Le dit Cosnier et le Francq nous ont dict et faict voir que la cheminée de la chambre quy est au boult vers le jardin est surplombée dans le contrecoeur et contredos depuis le bas jusques au hault et que est nécéssaire de de démollir et la faire à neuff et aussi de démollir les housses et languettes tant de la cheminée d´embas que de la cheminée de la chambre au dessus et de les refaire et la teste des dites cheminées de tuffeau comme elles sont et pour fournir matériaux oeuvre de main se servant et dispozant des vieux il coustera la somme de deux cens livres.
Les dits charpentiers ont dit que la porte quy est pour entreren la dite chambre basse et quy est dans la closture de terrasse est nécéssaire d´estre changée et que la place de la dite chambre n´est tuillée pavée ny planchée et est humide et pour y pouvoir loger et demeurer ont dit qu´il nécéssaire de la plancher de bois de chesne et pour founir les planches chevrons et clous il coustera la somme de cent soixante dix livres.
A la fenestre quy est au pignon vers le jardin et à l´austre fenestre vers le devant et placittre de St Jullien ont faict voir les dits charpentiers que les fenestres sont de nulle valleur et dit que est nécéssaire d´y en faire et meptre de neuff qui cousteront mis en place avecque leur serrure trente livres.
Les terrasseurs ont faict voir que la dite chambre n´est garnye ny blanchye ni le plafond et terrasse qui sont de la dite chambre et que la terrasse et clouaizon de la ditte chambre est de nulle valleur et dict qu´il est nécéssaire de garni, blanchir et faire la dite terrasse et pour fournir les matériaux et l´oeuvre de main (..) il coustera la somme de quarante cinq livres.
A l´autre chambre au bout du dit département du Sr du Parun les dits Cosnier et Le Francq ont montré que à la cheminée de la dite chambre le manteau est de bois et dict qu´il est nécéssaire de l´oster pour y en meptre un de grisson et pour le faire et démonter et refaire la housse qu´il coustera la somme de vingt quatre livres.
Les dits charpentiers ont faict voir que la dite chambre n´est point tuillée planchée ny pierrée et pour en pouvoir jouiret en servir ont dit qu´il est nécéssaire de la plancher comme l´autre du dit département et à la fenestre d´y en meptre une neuve au lieu de celle quy est de nulle valeur ce quy coustera pour fournir tous matériaux et oeuvre de main et aussy pour plancher l´allée entre deux la somme de cent soixante quinze livres.
Les dits terrasseurs ont dit et faict voir que la dite chambre a esté aultrefois blanchy avecque le guipon et qu´il est et néanmoins nécéssaire de garnir le tout de la dite chambre et plafond et aussy de refaire à la clouaizon de terrasse du costé de l´allée et blanchir le tout et pour fournir matériaux se servant des vieux qu´il coustera la somme de quatre vingts livres.
Ont aussy les dits charpentiers fait voir que l´escallier du dit département est pareil à celluy de l´autre département et aussy au plus incommode et dict qu´il est nécéssaire de la refaire et pour le rendre de service et commode qu´il fera comme cellui deziné pour l´autre départementet qu´il coustera pour matériaux et oeuvre de main dispozant des vieux la somme de trois cents livres.
A la chambre prochaine du pignon vers le jardin, ont les dits terrasseurs dict et fait voir qu´il est nécéssaire de regarnir par androitz blanchir le tout et en l´autre chambre au boult garnir en quelques endroitz et y meptre et aux dites chambres des tuilles et pour fournir matériaux et oeuvre de main ont dict et estimé qu´il coustera la somme de cens livres.
Les dicts vitriers ont dict qu´il est nécéssaire de deux croisées de viltres de deux panneaux chacunne aux deux fenestres de la chambre proche le jardin de vingtz pieds chacune croisée et une croisée à l´autre chambre de vingt pieds et fournir des gaulles de viltres et pour le tout qu´il coustera la somme de trente livres.
A la fenestre du pignon vers le jardin les dicts charpentiers ont dict que il est nécéssaire de faire la croisée des fenestres avecq sa ferme qui coustera mise en place dix huit livres.
Les dits Cosnier et Le Francq ont dict qu´il est nécéssaire de démollir la languette et housse de la cheminée de la chambre prochainne de celle du pignon et de l´estaige de haut qui surplombe en dedans et qui incommode et faict fumer la cheminée et pour fournir matériaux et oeuvre de main il coustera la somme de cent livres dispozant et se servant des vieux matériaux et faire la teste de tuffeau comme elle est.
Au grenier sur la chambre où est le pignon vers le jardin Les dits Cosnier et le Francq nous ont montré il y a un eucor servent de cheminée avecq jambaiges et courgs de pierre de taille et y manquent un manteau et housse qu´il est nécéssaire de meptre et faire et pour ce coustera la somme de trente livres.
Les couvreurs ayant aussi veu et visitté la couverture de la dite moitye des maisons acquises du Sr du Parun et tourillon d´escalier ont dict que y reste de la réparation de boutz de latte ardoize et chau et pour faire les dits réparations fournir les matériaux et oeuvre de main il coustera la somme de trente livres.
Aux petittes lucarnes qui sont dans la couverture ont les dits charpentiers où il n´y en a et qu´il est nécéssaire d´y en meptre et cousteront les dites fenestres quarante sols.
Au devant et placistre de la dite maison et en dépendant les dits expers ont faict voir qu´il n´y a de muraille et dict que pour la dicte maison il seroit nécéssaire d´y en faire.
Au cabinet estant en boult et coin du jardin,
Les charpentiers ont faict voir qu´il n´y a à l´estaige d´en hault que les seuls soliveaux sans plancher et que le bas n´est taillé ny planche et pour plancher le haut et bas fournir les planches de chesne chevron et cloux et coustera et plus l´oeuvre de main soixante dix livres.
Les dits terrasseurs nous ont faict voir que le cabinet par derier le dit jardin est faict de terrasse dont la garniture de sable et chau est tombet par le dehors et pour le regarnir en quelques endroitz par le dedans blanchir le tout fournir matériaux et oeuvre de main il coustera la somme de vingt livres.
Les vitriers ont aict voir que aux fenestres du dit cabinet il y manque deux panneaux entiers et un grand panneau qu´il faut remestre en plomb neuff et fournir huit pièces et qu´il n´y a aucunes gaulles de viltre et pour rendre le dit oeuvre de viltre en place qu´il coustera la somme de dix livres.
A la porte d´embas est une claveure sans cleff et à la porte de hault il n´y a ni claveure ny cleff et pour y en mettre ont les dits charpentiers dit qu´il coustera la somme de cinquante sols.
A la couverture ont les dits couvreurs dict qu´il y manque quelques ardoizes faillante et garnir de chau pour faire la dite réparation et fournir les matériaux et l´oeuvre de main coustera cens sols.
Aux deux portes du jardin ont faict voir que à celle sur le chemin une locquetouers et dict qu´il est nécéssaire d´y meptre une serrure et cleff et reparer celle de la dite portece qui coustera la somme de soixante sols.
Et tous les dits experts ayant veu les enclos du jardin ont trouvé et faict voir que entre le dit jardin et les jardins qui sont voisins et de la rue St Jullien il n´y a qu´un boult de muraille encommense de la longueur d´environ trois toizes etant tous unanimement dict que pour la conservation du dit jardin et en pouvoir surement jouir et empescher que les fruitz et légumes soient dérobés et emportés il est nécéssaire de faire continuer entre les dits jardins la dite muraille encommenser jusqu´à la muraille de la cour qu´ils ont mezuré et trouvé y avoir dix neuff toizes de longueur et huit piedz la toize et de haulteur environ neuff piedz hors toize qui coustera pour fournir matériaux comme pierre de massonaige chau et sable la somme de quatre cens livres.
Et ont tous les dits experts unanimement dict que est nécéssaire de faire les réparations de la dite maison dont ils ont parlé avant que l´on si puisse commodement loger.
Et est le rapport des dits expertz qu´ils ont affirmé véritable et ont les dits Chaussonier, Cosnier, Gatro, Phelipot, Pereul signé et ont les aultres par serment afirmé ne savoir signer et à leur requeste ont signé du dit Bellin François Bourdonnec du dit Tohot Vincent Bigaré du dit Mollay Pierre Guyot du dict Garderel Gilbert Fleuri du dict Le Francq Jan Legal clercqs présents estantau dit Vennes les dits jour et an (interligne sont pozés à taille il est nécéssaire de main fors sur douze piedz de massonnaige la rebastir tuilles vingt chevrons faicte de la cheminée la dite fenestre à présent laquelle aussi hérissonner les dit sapin il est et tuille bassaige et six et po qu´il coustera de plus qui la somme et solliveaux de la dite quelle cheminée po ont dit qu´il claveurs).
BIGARE, GUYOT
Ju. de la CHAUSSONIERE
BOURDONNEC
Jean PHILIPOT Jan LE GAL F. COSNIER
François LE GARO
Mathurin PEREUL, FLEURY
BOURDONNEC.





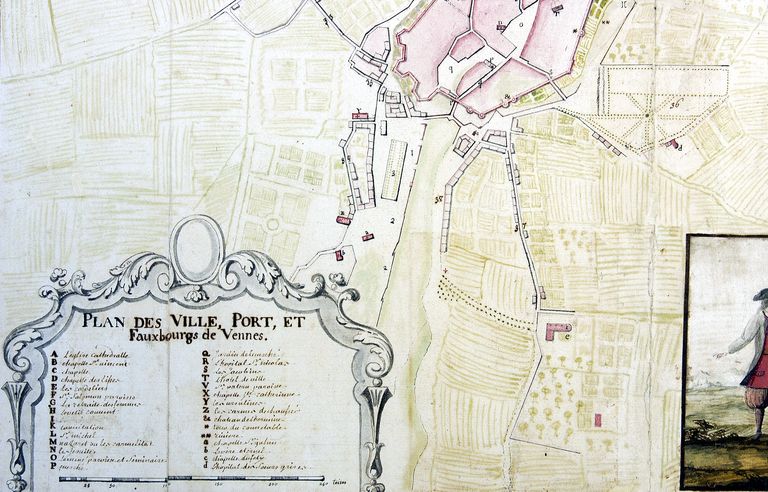
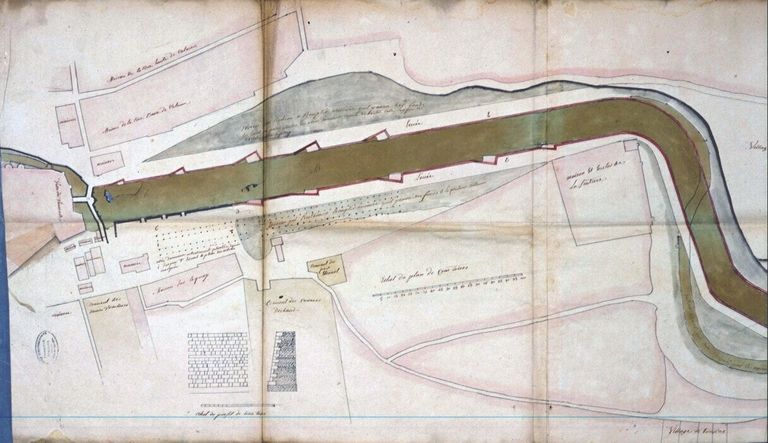
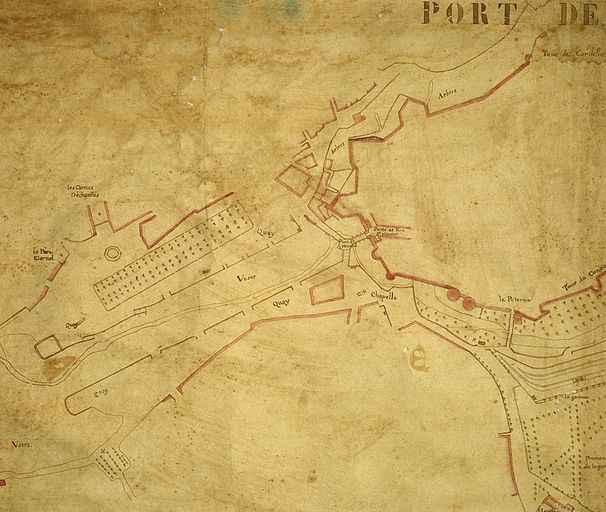
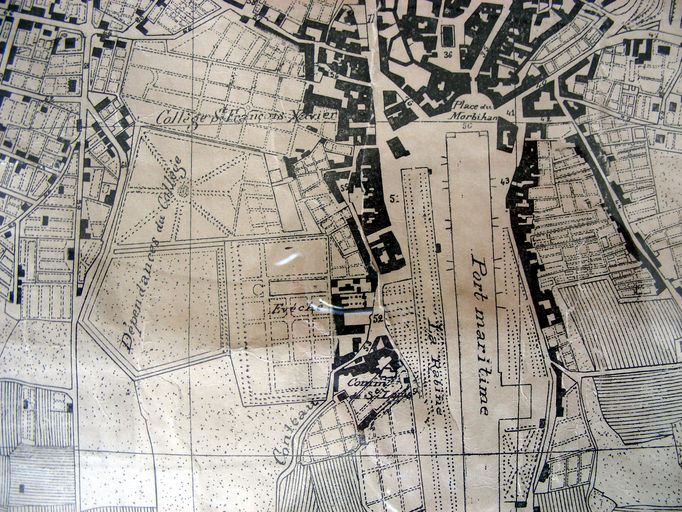

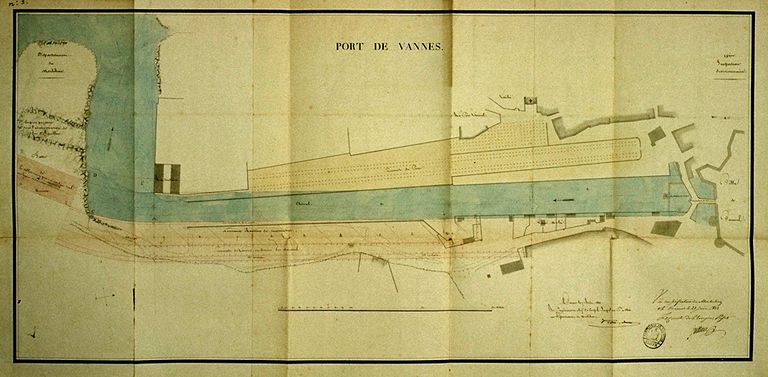
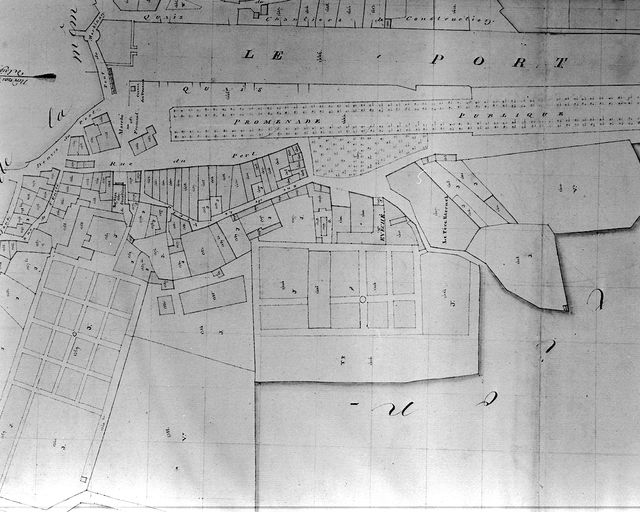

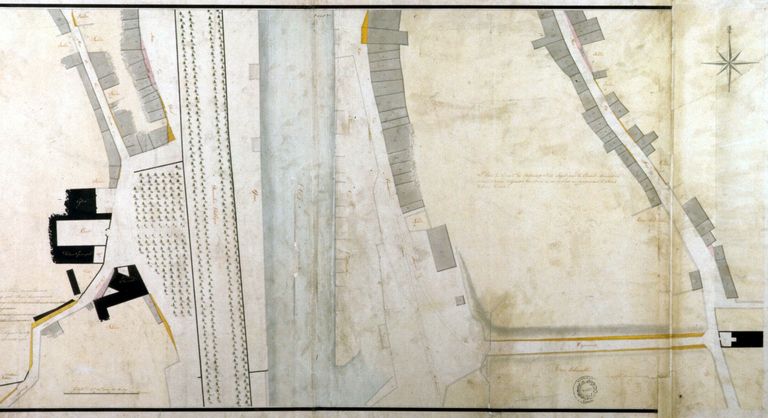
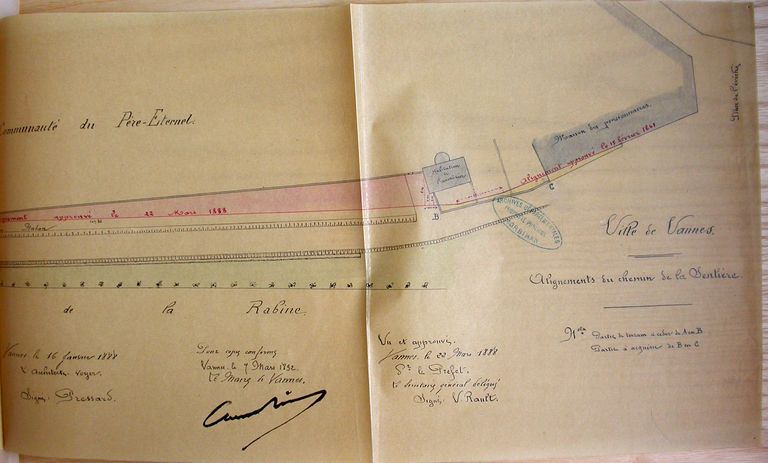
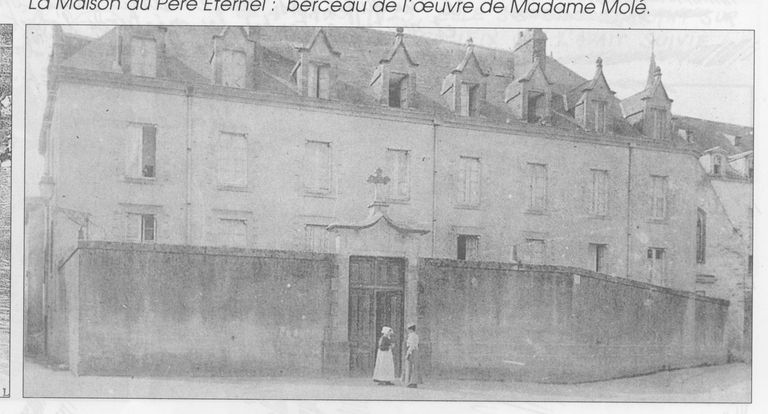





































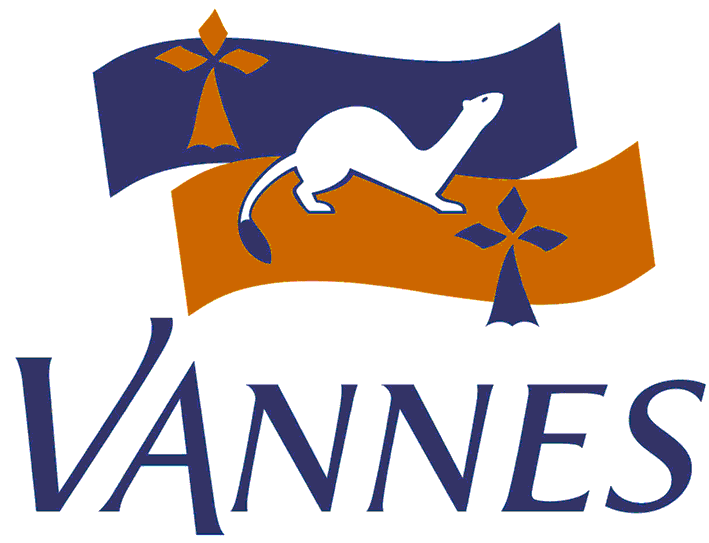
Géomètre